Luciano Canfora, Le copiste comme auteur, Éditions Anacharsis. (lu par Bernard Dufour)
Par Cyril Morana le 25 janvier 2013, 06:00 - Histoire de la philosophie - Lien permanent
 Luciano Canfora, Le copiste comme auteur, Éditions Anacharsis, 2012, Traduit de l’italien par Laurent Calvié et Gisèle Cocco. Préface de Laurent Calvié. Apostille inédite de Luciano Canfora.
Luciano Canfora, Le copiste comme auteur, Éditions Anacharsis, 2012, Traduit de l’italien par Laurent Calvié et Gisèle Cocco. Préface de Laurent Calvié. Apostille inédite de Luciano Canfora.
Nous croyons que le travail du philologue
moderne spécialiste de l’antiquité classique consiste à retrouver le texte
original des œuvres en corrigeant non seulement les incertitudes dues aux dommages subis par
les manuscrits mais surtout les multiples
erreurs que les copistes ont
commises pendant des siècles. C’est une illusion.
Le texte : «original», résultat d’une publication unique tel que nous le concevons depuis l’invention de l’imprimerie n’a jamais existé dans l’antiquité car les auteurs avaient l’habitude de revenir constamment sur la première édition, récrivant et reformulant leur texte sous l’influence de leur entourage. Et, matériellement, les manuscrits d’auteur ont été très endommagés, souvent dès le début lorsqu’ils étaient encore sous forme de feuillets et de tablettes et non de rouleaux. D’où, dès cette époque, les nombreuses incertitudes dans l’attribution des œuvres comme le discours Sur l’Halonnèse que les critiques anciens, pour des raisons matérielles et stylistiques, hésitaient à attribuer à Démosthène. Ou encore les difficultés qu’évoque Strabon, sous Auguste, pour reconstituer, au 1er siècle après J-C, les traités d’Aristote à partir des notes de ses élèves.
L. Canfora ne se contente pas de défaire cette illusion, il la retourne . Comme l’indique le titre, nous devons considérer les copistes de ces oeuvres comme les véritables artisans du texte voire comme leur auteur, au sens étymologique du terme, car le résultat de leur travail ne fut pas une reproduction à l’identique mais une :« intervention originale ». La copie de manuscrits procède en effet d’une lecture au sens fort du terme, supposant une appropriation dont nous n’avons plus l’idée à cause des photocopies modernes qui constituent au contraire des lectures toujours différées. Un copiste, nous explique Canfora, ne nous livre qu’un texte qu’il comprend. Sinon, animé du désir de lui donner « le meilleur » sens, comme le Pierre Ménard que Borgès nous présente dans Fictions s’efforçant de devenir Cervantès pour rétablir l’original du Quichotte, il récrit le texte que ses prédécesseurs auraient pu écrire si, de son point de vue, ils ne s’étaient pas trompés. Toute erreur du manuscrit qu’il a sous les yeux fait ainsi l’objet d’une interprétation, même les erreurs mécaniques, car toute faute, interprétée comme lapsus, devient : « conceptuelle ». Plagiaire sans malice, il se sent_et devient effectivement pour Canfora_ co-auteur, car, de proche en proche, de copie en recopie sur plusieurs siècles, on a affaire à une œuvre collective. Sans doute, lorsque le copiste appartient à la même culture que l’auteur, par exemple à la civilisation byzantine, les modifications sont-elles faibles. Mais que penser de l’ « originalité » du codex Veronensis, unique texte conservé des poésies de Catulle après mille cinq-cents ans, soit trente générations de copistes ?
Néanmoins,
ce rêve d’un texte original, nous dit Canfora, est soutenu chez les philologues
par un moderne substitut : l’archétype. On nomme ainsi l’ancêtre commun
unique obtenu par la méthode dite généalogique, ou stemmatique, établissant des
liens de dépendance entre manuscrits par analyse des fautes communes. Elle repose en fait sur une présomption que
L.Canfora conteste dans tout son livre : celle de la verticalité de la
tradition. Strabon lui-même constate la pluralité des textes d’un même traité
d’Aristote qu’il attribue à des conjectures très différentes de grammairiens
alexandrins mais aussi à l’édition par des libraires sans scrupules de versions
jugées : « préférables ». Mais la raison principale qui rend exceptionnelle l’existence d’un tel texte
original dans l’antiquité fut l’échange constant des livres et la pratique du
prêt en vue de copies à partir des grandes bibliothèques publiques comme celle
d’Alexandrie qui en faisait des centres de multiplication des variantes et
de contamination entre les textes. L’ancêtre unique de la reconstitution
stemmatique est séparé de l’original par un immense espace qui est justement
l’histoire du texte. Il est donc rarement plus ancien que les exemplaires
médiévaux et reste le plus souvent fictif pour les grands auteurs d’Homère à
Démosthène, de Virgile à Cicéron et au Nouveau Testament qui ont connu une
infinité d’éditions dans l’antiquité tardive. Dans tous les cas la méthode
généalogique ne permet pas de remonter au-delà de la stabilisation des textes
et de leur codification en grec par les
alexandrins. Il en est de l’original, même sous la forme de l’archétype, comme
de la : « chose en soi » kantienne qui ne peut être
atteinte qu’à travers ces phénomènes que sont les manuscrits existants.
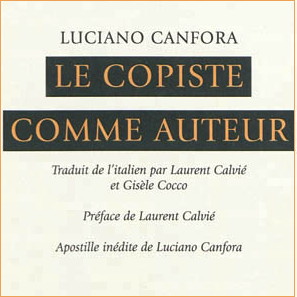
L.Canfora renverse alors la hiérarchie entre
la notion de tradition : «
directe » qui concerne les manuscrits, supposés plus proches de
l’original, et celle de tradition : « indirecte » où
un auteur cite un autre auteur. Les citations d’un texte sont en réalité
beaucoup plus proches de l’auteur même quand elles sont faites de mémoire. Dans
ce cas elles peuvent être des interprétations précieuses pour l’historien.
Ainsi lorsque Sénèque ( De Tranquillitate animi, IX,5 ) cite le texte perdu de Tite-Live
sur l’incendie de l’arsenal d’Alexandrie provoqué par Jules César en 48-47
avant J-C, une lecture attentive nous
apprend, au contraire de corrections hasardeuses sur les manuscrits d’autres
textes, qu’il ne toucha qu’une partie des volumes de la célèbre bibliothèque
qui provenait des collections royales et avaient été entreposés là pour y être admirés.
La tradition indirecte doit en réalité pour L.Canfora être intégrée à l’immense travail de traduction, parallèle à celui de la copie, qui va de l’influence des Mésopotamiens sur Hésiode à la latinisation d’Epicure par Lucrèce ou de Platon par Cicéron jusqu’à la traduction des auteurs grecs par les arabes, travail toujours accompagné par une réflexion sur la fidélité de l’acte de traduire et qui constitue le fond de notre civilisation écrite.
La difficulté d’accès à un texte original est encore accrue par une évolution technique malheureusement essentielle que Canfora qualifie de : « goulet » car elle est tragiquement responsable de la perte d’ une grande partie de la culture antique : celle qui voit les rouleaux de papyrus devenir des livres, sous la forme d’un codex ou rouleau unique. Les logoi deviennent des tomoi ou des biblia numérotés par groupe de cinq ou de sept. La perte d’un ou de plusieurs codex va entraîner une mutilation considérable des oeuvres. C’est ainsi que nous n’avons plus qu’un seul codex de sept tragédies pour Eschyle et pour Sophocle, un seul de sept comédies d’Aristophane dont les autres oeuvres étaient dejà introuvables au 10è siècle. Pour les historiens, nous n’avons conservé de l’œuvre de Polybe que cinq livres sur quarante, et dix livres, deux codex sur les quatre que comptait l’œuvre de Tite-Live ont disparu.
Canfora aborde alors le cas passionnant du livre-bibliothèque exemple parfait de tradition indirecte. L’idée de livre n’était en effet pas vraiment distincte dans l’antiquité de celle de bibliothèque dont le modèle sera celle d’Alexandrie. Cette tradition va se continuer au Moyen-âge, rassemblant étroitement culture profane et culture biblique comme en témoigne Isidore de Séville au 7è siècle lorsqu’il nous présente les deux livres, fondamentaux selon lui, qui pour les anciens renfermaient toutes choses, devenant par eux-mêmes des bibliothèques : la Bible et Homère. Il nous dit que l’Ancien Testament fut recopié par Esdras : « après l’incendie de la Loi » et nous parle aussitôt après de la bibliothèque fondée au 6è siècle avant J-C à Athènes par Pisistrate pour rassembler et ordonner les textes homériques qu’en 480 avant J-C Xerxès aurait emportée en Perse pour la sauver de l’incendie de la ville. Ce mythe, attesté dès Cicéron ( De oratore, III,37), et alimenté par les grammairiens byzantins qui imagineront a posteriori la bibliothèque de Pisistrate sur le modèle de celle d’Alexandrie et la mise en ordre des livres homériques faite par Soixante dix grammairiens correspondant évidemment aux Septante, inspirera jusqu’aux fresques de la Sixtine où les bibliothèques d’Alexandrie et de Babylone figurent la Bibliothèque sacrée d’Esdras.
Le livre-bibliothèque, recueil d’autres œuvres qu’il recense et résume, fut en réalité un véritable: « choix culturel » de l’antiquité classique inauguré par Diodore de Sicile au Ier siècle avant J-C avec sa Bibliothèque historique qui inspirera l’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien son contemporain dont l’influence jusqu’à la Renaissance fut considérable.
Mais l’héritier le plus remarquable de cette tradition du livre-bibliothèque, héros du livre de L.Canfora, est le patriarche Photios qui vivait à Byzance au 10 è siècle. Son Inventaire des livres que j’ai lus, que les humanistes intituleront avec raison Bibliothèque, recense 386 œuvres depuis Hérodote, combinant mentions, analyses et séries d’extraits d’œuvres que, pour beaucoup, nous ne connaissons que par lui. Cette Bibliothèque, en majeure partie théologique, avait été, malgré son titre initial, constituée par des notes de lecture d’un cercle de lecteurs autour de Photios à l’époque où il était encore laïc. Mais, devenu patriarche, il fut condamné par le Concile de 870. Le cercle fut dissous et les livres confisqués. Seul le fichier et des extraits échappèrent à cette persécution. Les originaux de ces extraits n’existent plus et avaient sans doute pour une partie déjà disparu au moment au moment de la collection. Mais, par exception, nous possédons encore le texte d’un auteur, en l’occurence Flavius Josèphe, ce qui nous permet de voir que même les extraits comportaient de nombreux ajouts et commentaires.
Canfora réfute alors un historien prestigieux
de l’antiquité : Edward Gibbon lequel, s’appuyant justement sur des
œuvres-bibliothèque comme celle d’Aristote,
Pline ou Galien, qui : « avaient lu et comparé les œuvres de
leurs prédécesseurs », estime que nous avons conservé l’essentiel de la
culture antique. C’est, pour Canfora, faire preuve d’un optimisme téléologique
digne de Pangloss car Gibbon sous-estime considérablement la quantité
d’ouvrages perdus. Diodore, déjà, a conscience
d’une perte importante d’ouvrages. L’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie,
qui n’est pas dû à César mais eut lieu dans
les années 270-275 avant J-C, car Strabon y travailla en 25-20 avant J-C, symbolise la fragilité des grandes bibliothèques
de l’antiquité contenant les principaux textes. Ce sont davantage les livres des bibliothèques
privées qui étaient éloignés des grands centres que nous avons conservés. Mais
les particuliers n’avaient le plus souvent pas jugé bon de recopier beaucoup de
grands textes très connus dont nous n’avons plus que le résumé. Pour L. Canfora
nous ne possèderions plus que le quarantième des œuvres de l’antiquité.
C’est l’idée principale de ce libre, remarquable par son érudition mais aussi par sa manière de nous faire vivre le drame d’une culture s’étendant sur un millénaire qui s’efforce désespérément de survivre en se concentrant dans de grandes bibliothèques, ou se diffusant chez des particuliers, ou encore se réfugiant dans des livres-bibliothèques pour échapper au feu ou aux destructions, sans vraiment y parvenir, et en dépit du travail acharné de milliers de copistes pendant des siècles. C’est le livre d’un savant, ce qui rend par moments la lecture un peu ardue. Malgré la progression des chapitres le livre comporte un assez grand nombre de redites, car il est sans doute constitué d’un assemblage de conférences.
Bernard Dufour