Jocelyne Sfez, L'art des Conjectures de Nicolas de Cues, éd. Beauchesne, lu par Baptiste Klockenbring
Par Jeanne Szpirglas le 19 avril 2013, 06:00 - Histoire de la philosophie - Lien permanent
 Jocelyne Sfez, L'art des Conjectures de Nicolas de Cues, éditions Beauchesne.
Jocelyne Sfez, L'art des Conjectures de Nicolas de Cues, éditions Beauchesne.
Après la parution l’an dernier de la traduction par Jocelyne Sfez des Conjectures de Nicolas de Cues, les éditions Beauchesne offrent aujourd’hui à la publication son vaste et consistant commentaire de ce même ouvrage, issu de son travail de thèse.
Cet ouvrage, d’une ampleur conséquente, propose ainsi une lecture scrupuleuse et approfondie d’une œuvre majeure, et pourtant assez peu commentée dans les études cusaines de langue française. Jocelyne Sfez s’attache à en montrer le caractère crucial tant dans l’œuvre du Cusain, que dans l’histoire même de la philosophie : situées à la charnière d’une métaphysique de l’être d’ascendance aristotélicienne et scolastique qui gouverne encore les premiers écrits de Nicolas de Cues, et en particulier la Docte Ignorance, d’une part, et d’autre partla métaphysique de l’Un qui le rapproche des néo-platoniciens, Les Conjectures constituent, à suivre l’auteur, l’articulation qui permet de comprendre l’évolution de l’œuvre cusaine dans son ensemble, fournissant en quelque sorte la clé de son unité, et jetant un pont entre les deux métaphysiques majeures de la philosophie médiévale. Mais par sa situation, entre Moyen-âge finissant et Renaissance, Les Conjectures sont aussi le lieu de l’émergence d’une nouvelle forme de savoir, non plus la science aristotélicienne du général et du nécessaire enracinée dans une métaphysique de la substance, ni même une théologie négative qui en reste tributaire, mais un savoir qui, sur le mode conjectural, se pense et se réfléchit en termes relationnels, qui fait des Conjectures tout à la fois une philosophie de l’esprit et un discours de la méthode, et dans lequel Jocelyne Sfez aperçoit les prémices de la science moderne.
Partant ainsi de la radicale inaccessibilité de l’Unité absolue qui constitue la Vérité dans son exactitude, et de la nécessité pour l’homme de n’y jamais avoir accès que dans l’altérité, Nicolas de Cues en déduit le caractère nécessairement conjectural de toute forme de savoir humain. En ce sens, Les Conjectures sont le lieu d’un déplacement considérable dans l’histoire de la pensée : le savoir n’a plus pour modèle la connaissance universelle et nécessaire de l’unité ; il se modèle bien plutôt sur l’art et la prudence aristotéliciens. L’inaccessibilité de l’unité contraint l’homme à procéder selon des conjectures, la vérité ne se laissant approcher que par la multiplication des conjectures et des perspectives, rendant par là-même nécessaire l’ouverture à l’autre, horizontalement aussi bien que verticalement, pour approcher de l’Un.
Le commentaire suivi des Conjectures, à travers l’étude systématique de l’articulation entre l’unité et l’altérité, conduit ainsi Jocelyne Sfez à une approche pluridisciplinaire et transversale de l’œuvre, mettant en évidence et explicitant les nombreuses références non seulement à la théologie et aux Pères de l’église – références d’autant plus nécessaires à expliciter qu’elles sont bien souvent fondues dans le texte même des Conjectures – mais encore aux mathématiques, à la médecine, en passant par l’optique et même l’esthétique, qui éclaire de la sorte la genèse de l’ouvrage et des concepts qui la structurent.
Le plan de l’ouvrage suit ainsi celui de l’œuvre qu’il commente : après une introduction qui situe Les Conjectures dans l’œuvre cusaine et explicite les raisons pour lesquelles elles sont relativement négligées dans le commentarisme notamment français, Jocelyne Sfez commence par un « exposé théorique de l’art général des conjectures », auquel succèdent des exemples d’application concrète de l’art des conjectures, constituant un « approfondissement pratique » de cet art général.
L’une des raisons pour lesquelles Les Conjectures occupent une place relativement marginale dans l’histoire de la philosophie tient à ce qu’elles s’inscrivent dans la continuité de La Docte ignorance dont elles constitueraient le prolongement et le complément. Et de fait, la thèse majeure des Conjectures repose bien sur les acquis de la Docte Ignorance, qui établit que le seul savoir véritable de l’homme ne peut jamais être que celui de sa propre ignorance. En ce sens, on comprend que Les Conjectures prolongent la Docte Ignorance, au point qu’on a pu les concevoir comme ne formant qu’un seul et même ouvrage. Reste que Les Conjectures marquent aussi une rupture avec la Docte Ignorance, puisque Cues, s’avisant de ce que le principe rationnel de contradiction ne saurait trouver à s’appliquer à la théologie (Dieu échappant à la logique et à la raison), pose qu’il faut recourir au principe intellectuel de coïncidence des opposés en Dieu – et dès lors s’affranchir de la Quaestio et de la théologie de son temps. Or ce principe de coïncidence des opposés est lui aussi un principe conjectural si bien qu’il ne permet pas de se hisser jusqu’à la connaissance de Dieu, c’est-à-dire jusqu’à la vérité dans sa précision : l’Unité divine dans sa précision paraît ainsi hors d’atteinte de tout savoir humain.
Les Conjectures se présentent ainsi
comme l’invention « d’une nouvelle méthode dans les arts
d’investigation », permettant de s’approcher autant que possible de la
vérité, y compris dans les objets qui se dérobent à la connaissance humaine
(ainsi de la quadrature du cercle ou de l’individu vivant qui seront parmi les
exemples développés en seconde partie, mais aussi des choses divines) ;
cela se traduit par l’abandon de la forme du traité au profit d'un discours
personnellement adressé, confirmant la rupture avec la théologie scolastique.
Dès lors le lecteur se trouve lui-même embarqué dans la recherche conjecturale
de la vérité. Jocelyne Sfez souligne qu’en cela, Nicolas de Cues pose chaque
individu à la recherche du vrai, comme un miroir singulier de l’ensemble du
monde. Est-ce à dire qu’il faille renoncer à l'idée que Dieu est l’unique
vérité, et que, l’homme étant la mesure de toute chose, la vérité ne soit que
relative ? C’est ici que le concept de conjecture vient rendre compte de
la positivité de cette nouvelle méthode : certes, la conjecture est une
errance, une absence de savoir si par là on entend la connaissance universelle
et nécessaire de la vérité dans sa précision ; mais la conjecture est
aussi interprétation, procédant par analogie, et dévoilant le sens caché à
partir de signes manifestes. Lorsque Nicolas de Cues affirme que « la
précision de la vérité est inaccessible [et qu’] en conséquence toute assertion
positive humaine à propos du vrai est une conjecture », il n’en affirme
pas moins que « une conjecture est une assertion positive qui participe
dans l’altérité à la vérité telle qu’en elle-même » (Conj. 11, 57).
Ainsi Jocelyne Sfez peut-elle en avancer que : « la conjecture est véritablement une connaissance inadéquate de la vérité. Et [que] cette inadéquation n’est pas un défaut, elle est une richesse : car c’est cette connaissance inexacte, cette participation dans l’altérité à la vérité, selon un mode toujours singulier et particulier, qui rend du même coup possible la multiplicité indéfinie des points de vue sur cette vérité ». En cela, la forme conjecturale ouvre le discours qui cherche le vrai à une autre forme de l’altérité : autrui ; la recherche du vrai devient alors œuvre dont les enjeux sont aussi bien pratiques, éthiques et politiques, que théoriques, et offre ainsi un solide fondement à l’exigence de tolérance, puisque aussi bien, la vérité ne saurait être approchée par élimination de la différence, mais au contraire dans la convergence renvoyée à l’infini de la totalité des perspectives singulières qui la visent. La vérité n’est du reste pas seulement la fin des conjectures, elle en est aussi l’origine. L’homme conjecturant, en tant qu’il est imago dei, est créateur de ses conjectures comme Dieu est créateur du monde, la pensée « participant comme elle peut à la fécondité de la nature créatrice » (Conj. I, 1, 5) et réalisant en l’homme la ressemblance divine, mais ouvrant aussi une perspective intérieure sur la vérité divine. C’est du reste par cette analogie que l’on comprendra le caractère exemplaire des nombres : purs concepts, ils sont tout entiers rationnels sans altérité aucune, en quoi ils sont l’image symbolique de la précision divine inatteignable, mais sont aussi les figures analogiques et symboliques des créatures, réactivant ainsi la conception de l’homme comme imago Dei, et ouvrant la perspective de la connaissance de l’univers par l’âme humaine qui se connaît elle-même. Ainsi la conjecture est-elle ce qui sépare l’homme de la vérité, tout autant que ce qui le relie à elle. Il reste alors à poser les jalons d’une méthode qui permettra d’ordonner ces conjectures, de les hiérarchiser afin de progresser vers des conjectures toujours plus vraies : ce qui sera l’objet d’une véritable méthode, avec ses principes et ses figures manuductrices P et U, consistant en des schémas généraux d’interprétation applicables à toute question, guidant ainsi la main de qui recherche la vérité.
Ainsi Jocelyne Sfez nous entraîne-t-elle à suivre la progression des Conjectures : partant des acquis de la Docte Ignorance, qui aboutissent à la notion de conjecture, le second chapitre analyse l’idée du Cardinal selon laquelle les conjectures sont l’œuvre propre de la pensée humaine dont Nicolas de Cues montre l’analogie avec la pensée divine à l’origine du monde. Elle y détaille ainsi l’idée cusaine de nombre dans ses sources et sa portée, montrant qu’elle est le pivot autour duquel s’articule l’analogie qui fonde la conjecture et sa fécondité. Le troisième chapitre approfondit les sources proclusiennes des Conjectures à travers la théorie des quatre unités, qui est l’occasion d’une critique sévère de la pratique de la Quaestio scolastique, dont Nicolas de Cues met en évidence l'inadéquation en matière de théologie : reposant tout entière sur le principe rationnel de non-contradiction, elle se révèle moins appropriée à son objet que le principe intellectuel de la coïncidence des opposés. Mais plus fondamentalement, elle repose sur la confusion des quatre régions de l’être (et de la mens), telles qu’elles résultent de la théorie proclusienne des quatre unités : au fond, la scolastique procède dans sa méthode d’une hypertrophie de la raison et de ses exigences, débordant des régions sensible et rationnelle (où la méthode de la distinction conceptuelle et le principe de non-contradiction a certes toute sa valeur) vers les régions de l’Intellect et de l’Un, où elle perd toute pertinence, et où la coïncidence des opposés doit prévaloir sur la non-contradiction, et la recherche de l’unité sur les distinctions conceptuelles.
Le chapitre quatre qui suit immédiatement expose la théorie cusaine des figures P (pour paradigmatique) et U (pour universelle), et creuse ainsi l’idée d’une manuduction au cœur de la méthode cusaine de la recherche de la vérité. La première figure (P) manifeste ainsi une profonde influence platonicienne sur Nicolas de Cues, à travers la mise en œuvre d’une symbolique renvoyant à une métaphysique de la lumière dans son opposition aux ténèbres, et qui est l’occasion pour Jocelyne Sfez de se livrer à une très stimulante élaboration de la notion d’altérité, mettant en évidence son ambivalence chez le cusain, entre alietas et alteritas. La figure P porte de même des traces de l’influence déterminante de Raymond Lulle et de son Ars generalis que Jocelyne Sfez analyse précisément, et des influences des sciences arabes et de l’optique médiévale dont l’auteur nous propose un utile rappel. Le propos assume alors une dimension esthétique inattendue, envisageant le rapport de Nicolas de Cues avec des peintres flamands et avec Alberti.
Reste que la figure P s’avère de portée limitée, ce qui amène Nicolas de Cues à élaborer une seconde figure, qui fait l’objet du chapitre 5 ; si la figure P consistait à examiner comment en toute chose s’articulaient altérité et unité, la figure U consiste à concevoir l’objet étudié comme une totalité, afin de détailler en son sein comment la diversité constitue ultimement une harmonie qui diffère et concorde, révélant ici une frappante homologie avec les Hiérarchies célestes du Pseudo-Denys.
La seconde partie de L’art général correspond au second livre des Conjectures, et est consacrée à la mise en pratique concrète de la méthode détaillée dans la première partie. Par là, Jocelyne Sfez, se fondant sur la réminiscence de Eth. Nic. VI, 3, indique combien la méthode cusaine des conjectures se rapproche bien davantage de l’Ars que de la science aristotélicienne ; il s’agit donc de montrer des exemples concrets et non d'en rester aux principes abstraits et généraux. La science stricto sensu d’ascendance aristotélicienne qui prévaut alors, part de la vérité (sous l’espèce de principes, immédiatement connus ou évidents pas soi), et consiste à passer de propositions vraies en propositions vraies. Pour Nicolas de Cues, au contraire, la vérité n’est pas au départ, mais à l’horizon de la perspective, véritable idée régulatrice qui guide « la chasse à la sagesse », et reste ainsi toujours à conquérir dans une approximation indéfinie ; de l’art aristotélicien, l’art des conjectures hérite son objet toujours particulier et contingent, dont la connaissance ne saurait relever de l’exactitude, tout en ressortissant de règles rationnelles. Cette comparaison avec l’art amène Jocelyne Sfez à explorer les nombreuses références cusaines à l’art médical, exemple typique d’art conjectural. On rencontre ici les figures d’Hippocrate, de Celse et derechef de Lulle, qui amènent l’auteur à conclure que tout le savoir humain, y compris mathématique, relève non de la science qui porte sur le général et le nécessaire mais bien plutôt de l’art qui porte sur le particulier et le contingent. Le chapitre 7 étudie l'application des figures P et U à la vision, laquelle amène Nicolas de Cues à théoriser les limites de notre connaissance et à réfléchir sur l’erreur. Dans cette perspective, est exposée une série d’exemples mathématiques, visant à délimiter les différentes régions gnoséologiques : celles de la raison ne devant pas déborder sur celle de l’intellect ou sur celle des sens. Dès lors les mathématiques mettront en évidence leurs propres limites, se révélant incapables, comme dans le cas de la quadrature du cercle, de résoudre les problèmes qu’elles ont pourtant elles-mêmes soulevés. Jocelyne Sfez montre ainsi à travers une minutieuse étude du problème de la quadrature du cercle, que pour Cues, la raison ne peut y trouver de solution, et qu’il faut ici recourir au principe des opposés, propre à l’intelligence : l’idée est ici de montrer que le problème de la quadrature du cercle ne peut être résolu que dans la coïncidence dans l’infiniment petit (par principe inatteignable) de l’arc et de la corde du cercle : la différence résiduelle étant ainsi à la fois réductible puisqu'on peut toujours l’approcher successivement, et irréductible puisqu’il y aura toujours un reste. Les mathématiques constituent dès lors le modèle de tout savoir humain dont la musique (troisième partie du quadrivium) constitue l’exemple suivant. A travers l’exploration des sources pythagoricienne et boécienne exploitées par Cues, Jocelyne Sfez détaille l'influence de l’évolution contemporaine de la musique, en plein essor polyphonique, sur la réflexion de Nicolas de Cues. Cette analyse musicale débouche sur une réflexion esthétique et constitue le pivot qui permet de passer du mathématisme du début de la seconde partie, aux modèles biologiques et organiques qui structurent la fin de l’ouvrage.
De fait, le chapitre huit explore la
dimension harmonique de la connaissance de toute chose, permettant de
comprendre que « le savoir est le savoir de la relation à l’autre, à tous
les autres ». Dans cette optique, le savoir conjectural apparaît comme
savoir de l’individu et de la relation, et constitue pour Cues, l'occasion de
développer une théorie des éléments, conçus eux-mêmes sur le mode relationnel.
Le chapitre neuf, développe l’exemple du modèle biologique dans
l’approfondissement de la détermination des modes d’être jusque dans le rapport
du corps et de l’esprit. Enfin, le dernier chapitre développe une véritable
anthropologie spirituelle de l’homme : l’homme, imago Dei et miroir, peut
ainsi prétendre être, par ses représentations, la mesure de toute chose, selon
sa contraction. C’est en effet dans le retour sur soi que l’âme humaine peut
fonder sa prétention au savoir de toute chose, même si de fait, nous nous
heurtons à tout instant à l’erreur. C’est que nous confondons opinion et
connaissance vraie lorsque l’intellect est absorbé par la raison, ou lorsque
nous confondons sensation et imagination, ce qui arrive lorsque l’unité de la
raison est absorbée par l’altérité sensible. Ici, Les Conjectures se font philosophie
de l’esprit, ouvrant ultimement sur la connaissance de l’univers : l’ordre
de l’esprit, en tant qu’il se réfléchit, ouvre sur la découverte de l’ordre de
l’être, la connaissance de soi étant la voie de la connaissance du monde.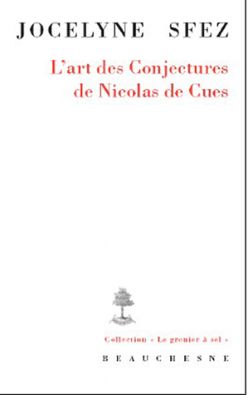
On ne peut qu’admirer le résultat de ce travail que l’on devine patient et méticuleux, et qui dénote une parfaite maîtrise d’un univers conceptuel d’une remarquable complexité. On perçoit la virtuosité technique que requièrent la lecture et l’explicitation de l’œuvre d’un esprit aussi puissant que vaste, explorant des directions aussi diverses que la théologie, la métaphysique, les mathématiques, la musique médiévale (qui donne lieu à une passionnante analyse), la médecine, les théories physiques ou encore l’optique et la théorie esthétique. L’érudition, dont un appareil de plus de six cents notes témoigne, et qui promet de faire de cet ouvrage une référence incontournable, ne le cède en rien au souci permanent de ramener le lecteur aux enjeux véritablement philosophiques qui se nouent dans Les Conjectures et plus largement chez Nicolas de Cues ; Jocelyne Sfez ne se contente pas de restituer la logique et la cohérence de l’argumentation cusaine, elle la dynamise, ouvrant régulièrement, par de simples allusions parfois, des perspectives stimulantes, par exemple sur la philosophie du langage, sur l’esthétique ou encore sur la philosophie des formes symboliques, sur la philosophie morale ou politique – on attend à cet égard son ouvrage annoncé sur Nicolas de Cues à l’épreuve du politique. C’est à tous ces égards un ouvrage qui fait authentiquement œuvre de philosophie.
Baptiste Klockenbring