Dominique Schnapper, L’esprit démocratique des lois,Gallimard, « NRF-Essais »2014 Lu par Jean-Claude Poizat
Par Florence Benamou le 19 février 2016, 06:00 - Philosophie politique - Lien permanent
Chers lecteurs, chères lectrices,
Les recensions paraissent et disparaissent très vite ; il est ainsi fort possible que certaines vous aient échappé en dépit de l'intérêt qu'elles présentaient pour vous. Nous avons donc décidé de leur donner, à elles comme à vous, une seconde chance. Nous avons réparti en cinq champs philosophiques, les recensions : philosophie antique, philosophie morale, philosophie esthétique, philosophie des sciences et philosophique politiques. Pendant cinq semaines correspondant à ces champs, nous publierons l'index thématique des recensions publiées cette année et proposerons chaque jour une recension à la relecture. Au terme de ce temps de reprise, nous reprendrons à notre rythme habituel la publication de nouvelles recensions.
Recensions de philosophie politique
`Recensions de philosophie antique
Recensions de philosophie morale
 Dominique Schnapper, L’esprit démocratique
des lois,Gallimard, « NRF-Essais »2014 Lu par Jean-Claude Poizat
Dominique Schnapper, L’esprit démocratique
des lois,Gallimard, « NRF-Essais »2014 Lu par Jean-Claude Poizat
Le dernier ouvrage de la sociologue, politologue et philosophe française Dominique Schnapper, L’esprit démocratique des lois, paru au début de l’année, a pour objet l’analyse des grandes tendances sociales et culturelles actuellement à l’œuvre dans les démocraties occidentales, et tout particulièrement en France. En suivant l’inspiration de l’auteur de L’esprit des lois auquel le titre rend hommage, D. Schnapper entend porter son éclairage non pas tant sur les institutions politiques démocratiques en tant que telles, que sur les « mœurs » et les « manières » de vivre des individus en démocratie, ou autrement dit sur ce que Montesquieu appelait : « l’esprit général d’une nation » (Esprit des lois, XIX, 4). La philosophe poursuit de la sorte une réflexion entamée de longue date, depuis les premiers ouvrages qui ont établi sa réputation de sociologue et de politologue, à savoir notamment : La communauté des citoyens, sur l’idée moderne de nation (1994) et La relation à l’autre, au cœur de la pensée sociologique (1998), jusqu’aux ouvrages plus récents comme : La démocratie providentielle, essai sur l’égalité contemporaine (2002) et Une sociologue au Conseil constitutionnel (2010).
La thèse principale du livre consiste à défendre l’idée d’une irréductible séparation ainsi que d’une permanente contradiction entre deux dimensions de ce que l’on appelle communément la « démocratie, à savoir : d’une part, un certain type de régime politique, fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les hommes et de leur vocation à la liberté garantie par l’Etat de droit, et, d’autre part, une dynamique sociale reposant sur l’aspiration infinie des individus à l’extension continue de leurs droits subjectifs ainsi que leur refus de toute limitation imposée à ces droits par des contraintes, tant sociales que naturelles, qui leur seraient extérieures. On reconnaîtra sans peine ici une réflexion analogue à celle qui avait été développée par un autre penseur libéral français, après son retour d’un voyage en Amérique vers le milieu du XIXe siècle. S’il est vrai que la « passion de l’égalité », telle que décrite et analysée par Tocqueville, est une passion exclusive « qui pénètre de toutes parts dans le cœur » des individus vivant en démocratie, elle risque selon le philosophe de se transformer quelquefois en « délire » et de rendre les hommes « sourds » à toute autre exigence, notamment à cette autre grande exigence démocratique qu’est la liberté. C’est ainsi que l’auteur de La démocratie en Amérique entendait déjà montrer, il y a près de deux siècles, le conflit de valeurs qui travaillerait, selon lui, la démocratie en son cœur et qui menacerait de la détruire de l’intérieur. De fait, c’est à une critique tout à fait similaire de la démocratie, à une critique dite « interne » portant sur les effets et les excès de la « dynamique démocratique » (par opposition à une critique « externe » portant sur les manquements et les insuffisances de la réalisation de la démocratie au regard de ses valeurs et de ses principes fondateurs), que D. Schnapper entend se consacrer dans son ouvrage : « Ce sont les vertus de la démocratie et le risque que les individus démocratiques ne partagent plus des valeurs et une conception du monde commune que je souhaite analyser ici. Si la société démocratique, poussée par sa propre dynamique, devenue extrême, en venait à confondre les ordres, les personnes et les valeurs, cela pourrait remettre en cause l’existence même du monde commun nécessaire à toute société, et plus particulièrement à une société qui n’admet aucune légitimité extérieure à elle-même » (Introduction, p. 26-27). Ces analyses s’inscrivent en outre dans le prolongement de celles que la sociologue avait déjà entreprises dans un précédent ouvrage consacré à ce que l’on appelle habituellement en France « l’Etat-providence », intitulé La démocratie providentielle, essai sur l’ égalité contemporaine. Elles consistent en quelque sorte à actualiser les analyses tocquevilliennes pour les replacer dans le contexte contemporain de ce que l’on pourrait appeler « la crise de l’Etat-providence ». Ici, une seconde thèse à la fois sociale, politique et même philosophique se dégage clairement des analyses de D. Schnapper : à savoir que cette crise ne serait pas seulement une crise conjoncturelle liée à un contexte économique passagèrement défavorable, mais bien une crise structurelle liée à un vice de structure inhérent à la « démocratie providentielle » (ou à la « démocratie sociale ») en tant que telle. « Parce que ni l’égalité ni le bien être n’ont de limites intrinsèques, écrit D. Schnapper, le déficit de la démocratie providentielle, dans ce sens large, n’est pas seulement lié aux effets de la crise financière et aux transformations les plus récentes du capitalisme, il est structurel. Tous les besoins des hommes sont en tant que tels légitimes. Par définition, ils ne comportent pas de limites et se renouvellent au fur et à mesure que se transforment les sociétés. (…) L’Etat-providence nourrit les insatisfactions parce que la réponse tarde toujours par rapport aux demandes et que les ressources sont par définition limitées quand les besoins, donc les exigences, sont illimitées » (Introduction, p. 24). La dernière phrase résume plus particulièrement, à elle seule, le paradoxe et la contradiction qui constituent, selon la sociologue, le cœur de la crise que traverse actuellement l’Etat-providence : un certain type historiquement déterminé et particulier d’organisation politique (rappelons qu’il a été mis en place en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale), reposant sur l’intervention de l’Etat dans tous les domaines de la vie économique et sociale des individus dans le but de leur procurer le bien être ou le « bonheur », ne réussirait en fait qu’à susciter l’insatisfaction permanente, la frustration et même l’humiliation, autrement dit : le malheur de ces mêmes individus. Il convient ici de noter qu’en abordant la question du désir et du bonheur humains, D. Schnapper tend à dépasser la sphère de connaissance proprement sociologique, pour rejoindre un champ de réflexion qui était traditionnellement dévolu aux philosophes et ayant pour objet rien de moins que la sagesse. Autrement dit, il n’en va pas seulement ici d’une récollection empirique de données, fussent-elles attestées par des enquêtes sociologiques dûment menées, mais aussi et surtout d’une certaine manière de les intégrer à une compréhension d’ensemble qui leur donne sens. Comment faut-il interpréter la crise contemporaine de l’Etat-providence ? Quelle direction, quel cap doivent suivre les politiques publiques afin de nous permettre d’en sortir ? Le moins que l’on puisse dire est que la question est d’actualité. Or la réponse de D. Schnapper, en un sens, ne l’est pas. Elle comporte en effet une dimension inactuelle qui la rattache, comme on vient de le dire, à la tradition de pensée philosophique, ce qui lui permet de réinscrire la situation de notre temps, marqué par une certaine agitation de court terme face aux sollicitations bruyantes de l’ « urgence », dans le temps long et lent qui est nécessaire tant à la réflexion qu’à l’action véritables. Si un grand nombre de penseurs contemporains se sont penchés sur la crise de l’Etat-providence, il s’en faut de beaucoup que tous s’accordent tant sur les causes de celle-ci que sur les solutions ou les remèdes à lui apporter. Faut-il préserver le régime de l’Etat-providence dans sa double composante mêlant la forme « stato-nationale » et l’interventionnisme socio-économique, avec toutes les difficultés et tous les risques de dérives que cela comporte ? Ou bien faut-il au contraire y renoncer absolument, afin de couper au plus court vers une forme de démocratie qui soit radicalement révolutionnaire, égalitaire et sociale ? Ou bien encore, faut-il accompagner les mutations contemporaines de la vie sociale et politique, en adaptant la citoyenneté aux nouvelles conditions ainsi créées, en déconnectant celle-ci notamment de la forme stato-nationale et en l’ouvrant aux potentialités infinies de la société marchande mondialisée ? D. Schnapper quant à elle ne retient aucune de ces « solutions », mais propose de revenir à une situation antérieure à l’institution de l’Etat-providence, à une conception somme toute très classique de l’Etat-nation, basée à la fois sur l’idée de la souveraineté du peuple (ou de l’autolégislation) et sur le respect de la liberté individuelle et des droits fondamentaux. Autrement dit, il s’agirait de suivre une voie moyenne, celle du « juste milieu » raisonnable ou de la « médiété » (en un sens proche de la conception aristotélicienne de la vertu), en s’avisant avec Montesquieu du fait que la démocratie moderne est constamment menacée sur deux fronts : « Le principe de la démocratie se corrompt, non seulement lorsqu’on perd l’esprit d’égalité, mais encore quand on prend l’esprit d’égalité extrême, et que chacun veut être égal à ceux qu’il choisit pour lui commander. Pour lors, le peuple, ne pouvant souffrir le pouvoir même qu’il confie, veut tout faire par lui-même, délibérer pour le sénat, exécuter pour les magistrats, et dépouiller tous les juges. Il ne peut plus y avoir de vertu dans la république. (…) La démocratie a deux excès à éviter : l’esprit d’inégalité, qui mène à l’aristocratie, ou au gouvernement d’un seul, et l’esprit d’égalité extrême, qui la conduit au despotisme d’un seul, comme le despotisme d’un seul finit par la conquête » (Esprit des lois, VIII, 2 – cité par D. Schnapper, op. cit., p. 144). Certes, cette pensée « moyenne » n’a pas de quoi susciter de grands enthousiasmes, elle n’autorise guère les élans rhétoriques ni les envolées lyriques, elle ne saurait donc rassasier des esprits assoiffés d’absolu qui seront tentés, en raison même de leur propre tropisme, de la qualifier de « médiocre ». Or tel est précisément son but : décevoir en la démystifiant toute prétention à l’absolu, particulièrement lorsque cette prétention s’inscrit dans l’ordre social et politique où elle n’a pas sa place (du moins dans une société politique et démocratique moderne), afin de la renvoyer à la sphère de la conscience et de la vie individuelles où elle peut s’épanouir sous la forme de croyances et de pratiques religieuses strictement privées. Il n’empêche : les esprits chagrins ne manqueront pas, derechef, de souligner combien les formes juridiques et politiques de la démocratie contemporaine ne sauraient nous donner entière satisfaction, c’est pourquoi ils en appelleront à un élan supérieur, à une sorte de supplément d’âme social et politique. Or la démocratie institutionnalisée autorise et même exige toutes les contestations possibles et imaginables, pourvu que celles-ci s’inscrivent dans le cadre du respect de la loi. D. Schnapper, au détour d’une rapide allusion au dialogue platonicien du Criton, nous invite ainsi à reconsidérer l’héroïsme discret de « Socrate [qui] respectait la loi même s’il la trouvait injuste » (p. 134). Autrement dit, la démocratie institutionnelle est une forme politique certes fixe mais pas figée, puisqu’elle prévoit, dans sa forme même (au travers par exemple du droit de manifester), la possibilité de l’émergence de mouvements « informes » qui tendent à la bousculer afin de la faire évoluer. Est-ce à dire que ce type de régime contiendrait la solution de toutes les contradictions : contradiction de l’immobilité et du mouvement, de l’institutionnel et du spontané, de la tradition et du changement, de l’ordre et de la justice etc. ? A tout le moins, il offre un compromis toujours fragile et instable, pour cela même souple et pérenne, dont le principal mérite est de ne pouvoir prolonger son existence un seul instant sans la vigilante sollicitude et la bienveillante attention des individus qui en dépendent autant qu’il dépend d’eux. Au fond, est-ce que nous ne retrouvons pas ici les termes de l’intemporel dialogue de Philinte et Alceste dans la célèbre pièce de Molière ? Au fameux « misanthrope », plein d’aigreur et de fiel, qui se plaint continuellement « de voir qu’avec le vice on garde des mesures », qui exige une sanction immédiate et absolue contre toutes les injustices des hommes, Philinte donne cette réplique empreinte d’une sagesse pleine de « bonhomie » : «Il faut parmi le monde une vertu traitable/A force de sagesse, on peut être blâmable/La parfaite raison fuit toute extrémité/Et veut que l’on soit sage avec sobriété ».
D. Schnapper nous met ainsi en garde contre tous les Alceste contemporains, en élevant ses analyses sociales et politiques au niveau des préoccupations qui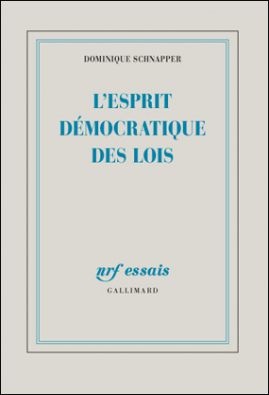 sont traditionnellement celles des « sages », des écrivains ou des philosophes : «Pour maintenir l’ordre démocratique, il faut résister à la tentation de condamner indistinctement toutes les réalisations concrètes, des meilleurs aux plus discutables ou aux plus condamnables, au nom d’une conception absolue et théorique de ce que devrait être la démocratie. La distinction dans le jugement est une vertu démocratique » (Conclusion, p. 291). Contre ce qu’elle appelle le « fondamentalisme démocratique », la sociologue vante le mérite de la relativité des points de vue (lequel ne se confond pas avec un relativisme absolu) comme aussi de la « modestie », tout en prenant acte du fait qu’il est souvent « plus aisé de céder au plaisir de la dénonciation radicale, au nom du droit à juger absolument, facile à exercer dans les sociétés libres, et souvent rentable dans le monde des intellectuels et des medias » (op. cit. p. 292). Toutefois, il nous semble que ce ne serait pas faire injure à sa prudente modération ni à sa modestie que de soutenir, en guise de conclusion, le paradoxe selon lequel la réflexion de D. Schnapper, sous ses dehors « raisonnables », peut apparaître comme une pensée véritablement « révolutionnaire », dans la mesure où elle va totalement à rebours de la « doxa » dominante, et où elle nous invite à une radicale conversion des esprits, prélude à un réel changement de nos pratiques sociales et politiques. Les doctrines soi-disant « révolutionnaires » qui nous invitent régulièrement et de façon insistante à renverser l’ordre établi, à transgresser les interdits ou les tabous, à subvertir les normes conventionnelles, que ce soit dans l’ordre politique, moral, esthétique, sexuel etc. ne sont-elles pas devenues aujourd’hui très conventionnelles, très convenues et même très « convenables » ou très « comme il faut » ? Ainsi, par exemple, D. Schnapper a beau jeu de montrer comment, en France, dans le domaine artistique et culturel, « refusant le jugement académique, les artistes les plus transgressifs vivent à l’abri de la protection des pouvoirs publics » (op. cit. p. 175). Bien plus, ces doctrines ou, plus précisément, les fausses croyances qu’elles contribuent à diffuser dans la société, ne risquent-elles pas de ruiner les principes fondateurs de la démocratie politique moderne ? Alors qu’elle remarque que « l’homo democraticus juge avec indulgence des conduites illégales lorsqu’elles sont menées au nom d’un bien affirmé supérieur au droit positif, conception moderne d’une sorte de droit naturel » (op. cit. p. 117), D. Schnapper se demande si une telle indulgence est de nature à renforcer la « démocratie », ou bien si elle ne risque pas au contraire de favoriser de nouvelles formes de domination informelles ou « sauvages », pour le bénéfice des individus les plus forts, sans que les plus faibles ne bénéficient quant à eux des protections et des contre-pouvoirs que pouvaient leur offrir les institutions démocratiques ? Veut-on un dernier exemple ? La sociologue fait observer que la désinstitutionnalisation du mariage, si elle a eu l’heureux effet de « libérer » les individus du carcan de la vie familiale traditionnelle, a également eu pour effet secondaire de précariser la condition des femmes issues des milieux sociaux les plus modestes, de les rendre plus souvent victimes du chômage, de la pauvreté et de l’exclusion. D’une manière générale, les analyses de D. Schnapper nous rappellent donc à cette vérité républicaine que n’aurait pas désavouée Lacordaire, mais qu’une certaine « hubris » politique contemporaine tend à nous faire oublier: « l’affaiblissement du règne de la loi et des institutions favorise les plus puissants, lorsque le contrôle social est défaillant, les plus vulnérables sont fragilisés » (op. cit. p. 263).
sont traditionnellement celles des « sages », des écrivains ou des philosophes : «Pour maintenir l’ordre démocratique, il faut résister à la tentation de condamner indistinctement toutes les réalisations concrètes, des meilleurs aux plus discutables ou aux plus condamnables, au nom d’une conception absolue et théorique de ce que devrait être la démocratie. La distinction dans le jugement est une vertu démocratique » (Conclusion, p. 291). Contre ce qu’elle appelle le « fondamentalisme démocratique », la sociologue vante le mérite de la relativité des points de vue (lequel ne se confond pas avec un relativisme absolu) comme aussi de la « modestie », tout en prenant acte du fait qu’il est souvent « plus aisé de céder au plaisir de la dénonciation radicale, au nom du droit à juger absolument, facile à exercer dans les sociétés libres, et souvent rentable dans le monde des intellectuels et des medias » (op. cit. p. 292). Toutefois, il nous semble que ce ne serait pas faire injure à sa prudente modération ni à sa modestie que de soutenir, en guise de conclusion, le paradoxe selon lequel la réflexion de D. Schnapper, sous ses dehors « raisonnables », peut apparaître comme une pensée véritablement « révolutionnaire », dans la mesure où elle va totalement à rebours de la « doxa » dominante, et où elle nous invite à une radicale conversion des esprits, prélude à un réel changement de nos pratiques sociales et politiques. Les doctrines soi-disant « révolutionnaires » qui nous invitent régulièrement et de façon insistante à renverser l’ordre établi, à transgresser les interdits ou les tabous, à subvertir les normes conventionnelles, que ce soit dans l’ordre politique, moral, esthétique, sexuel etc. ne sont-elles pas devenues aujourd’hui très conventionnelles, très convenues et même très « convenables » ou très « comme il faut » ? Ainsi, par exemple, D. Schnapper a beau jeu de montrer comment, en France, dans le domaine artistique et culturel, « refusant le jugement académique, les artistes les plus transgressifs vivent à l’abri de la protection des pouvoirs publics » (op. cit. p. 175). Bien plus, ces doctrines ou, plus précisément, les fausses croyances qu’elles contribuent à diffuser dans la société, ne risquent-elles pas de ruiner les principes fondateurs de la démocratie politique moderne ? Alors qu’elle remarque que « l’homo democraticus juge avec indulgence des conduites illégales lorsqu’elles sont menées au nom d’un bien affirmé supérieur au droit positif, conception moderne d’une sorte de droit naturel » (op. cit. p. 117), D. Schnapper se demande si une telle indulgence est de nature à renforcer la « démocratie », ou bien si elle ne risque pas au contraire de favoriser de nouvelles formes de domination informelles ou « sauvages », pour le bénéfice des individus les plus forts, sans que les plus faibles ne bénéficient quant à eux des protections et des contre-pouvoirs que pouvaient leur offrir les institutions démocratiques ? Veut-on un dernier exemple ? La sociologue fait observer que la désinstitutionnalisation du mariage, si elle a eu l’heureux effet de « libérer » les individus du carcan de la vie familiale traditionnelle, a également eu pour effet secondaire de précariser la condition des femmes issues des milieux sociaux les plus modestes, de les rendre plus souvent victimes du chômage, de la pauvreté et de l’exclusion. D’une manière générale, les analyses de D. Schnapper nous rappellent donc à cette vérité républicaine que n’aurait pas désavouée Lacordaire, mais qu’une certaine « hubris » politique contemporaine tend à nous faire oublier: « l’affaiblissement du règne de la loi et des institutions favorise les plus puissants, lorsque le contrôle social est défaillant, les plus vulnérables sont fragilisés » (op. cit. p. 263).
Jean Claude Poizat