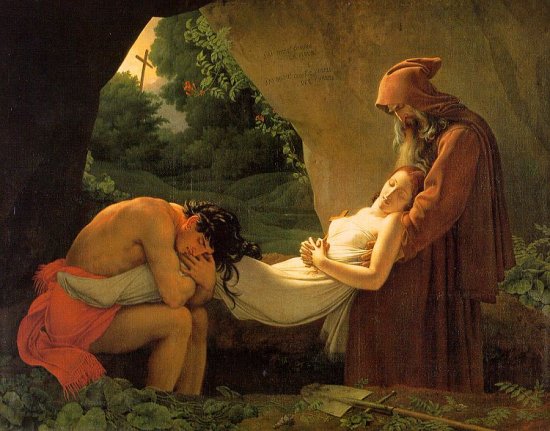Introduction:
Dans cet extrait de Madame Bovary, qui rend compte de sa mort par empoisonnement à l'arsenic, j'ai souligné tous les passages qui correspondent aux effets de l'ingestion de ce poison, tels qu'ils sont décrits, scientifiquement, dans un article d'encyclopédie que j'ai joint à la suite. Cela prouve bien que l'écrivain Flaubert s'est documenté de façon de très précise pour rédiger son roman.
LA MORT DE MADAME BOVARY
Elle sortit. Les murs tremblaient, le plafond l'écrasait ; et elle repassa par la longue allée, en trébuchant contre les tas de feuilles mortes que le vent dispersait. Enfin elle arriva au saut-de-loup devant la grille ; elle se cassa les ongles contre la serrure, tant elle se dépêchait pour l'ouvrir. Puis, cent pas plus loin, essoufflée, près de tomber, elle s'arrêta. Et alors, se détournant, elle aperçut encore une fois l'impassible château, avec le parc, les jardins, les trois cours, et toutes les fenêtres de la façade.
Elle resta perdue de stupeur, et n'ayant plus conscience d'elle-même que par le battement de ses artères, qu'elle croyait entendre s'échapper comme une assourdissante musique qui emplissait la campagne. Le sol sous ses pieds était plus mou qu'une onde, et les sillons lui parurent d'immenses vagues brunes, qui déferlaient. Tout ce qu'il y avait dans sa tête de réminiscences, d'idées, s'échappait à la fois, d'un seul bond, comme les mille pièces d'un feu d'artifice. Elle vit son père, le cabinet de Lheureux, leur chambre là bas, un autre paysage. La folie la prenait, elle eut peur, et parvint à se ressaisir, d'une manière confuse, il est vrai; car elle ne se rappelait point la cause de son horrible état, c'est-à-dire la question d'argent. Elle ne souffrait que de son amour, et sentait son âme l'abandonner par ce souvenir, comme les blessés, en agonisant, sentent l'existence qui s'en va par leur plaie qui saigne.
La nuit tombait, des corneilles volaient.
Il lui sembla tout à coup que des globules couleur de feu éclataient dans l'air comme des balles fulminantes en s'aplatissant, et tournaient, tournaient, pour aller se fondre sur la neige, entre les branches des arbres. Au milieu de chacun d'eux, la figure de Rodolphe apparaissait. Ils se multiplièrent, et ils se rapprochaient, la pénétraient ; tout disparut. Elle reconnut les lumières des maisons, qui rayonnaient de loin dans le brouillard.
Alors sa situation, telle qu'un abîme, se représenta. Elle haletait à se rompre la poitrine. Puis, dans un transport d'héroïsme qui la rendait presque joyeuse, elle descendit la côte en courant, traversa la planche aux vaches, le sentier, l'allée, les halles, et arriva devant la boutique du pharmacien.
Il n'y avait personne. Elle allait entrer ; mais, au bruit de la sonnette, on pouvait venir ; et, se glissant par la barrière, retenant son haleine, tâtant les murs, elle s'avança jusqu'au seuil de la cuisine, où brûlait une chandelle posée sur le fourneau. Justin, en manches de chemise, emportait un plat.
- Ah ! ils dînent. Attendons.
Il revint. Elle frappa contre la vitre. Il sortit.
- La clef ! celle d'en haut, où sont les...
- Comment ?
Et il la regardait, tout étonné par la pâleur de son visage, qui tranchait en blanc sur le fond noir de la nuit. Elle lui apparut extraordinairement belle, et majestueuse comme un fantôme ; sans comprendre ce qu'elle voulait, il pressentait quelque chose de terrible.
Mais elle reprit vivement, à voix basse, d'une voix douce, dissolvante :
- Je la veux ! donne-la-moi.
Comme la cloison était mince, on entendait le cliquetis des fourchettes sur les assiettes dans la salle à manger.
Elle prétendit avoir besoin de tuer les rats qui l'empêchaient de dormir.
- Il faudrait que j'avertisse monsieur.
- Non ! reste !
Puis, d'un air indifférent :
- Eh ! ce n'est pas la peine, je lui dirai tantôt. Allons, éclaire.moi !
Elle entra dans le corridor ou s'ouvrait la porte du laboratoire. Il y avait contre la muraille une clef étiquetée capharnaüm..
- Justin ! cria l'apothicaire, qui s'impatientait.
- Montons !
Et il la suivit.
La clef tourna dans la serrure, et elle alla droit vers la troisième tablette, tant son souvenir la guidait bien, saisit le bocal bleu, en arracha le bouchon, y fourra sa main, et, la retirant pleine d'une poudre blanche, elle se mit à manger à même.
- Arrêtez ! s'écria-t-il en se jetant sur elle.
- Tais-toi ! on viendrait...
Il se désespérait, voulait appeler.
- N'en dis rien, tout retomberait sur ton maître !
Puis elle s'en retourna subitement apaisée, et presque dans la sérénité d'un devoir accompli.
Quand Charles, bouleversé par la nouvelle de la saisie, était rentré à la maison, Emma venait d'en sortir. Il cria, pleura, s'évanouit, mais elle ne revint pas. Où pouvait-elle être ? Il envoya Félicité chez Homais, chez M. Tuvache, chez Lheureux, au Lion d'or, partout ; et, dans les intermittences de son angoisse, il voyait sa considération anéantie, leur fortune perdue, l'avenir de Berthe brisé ! Par quelle cause ?... pas un mot ! Il attendit jusqu'à six heures du soir. Enfin, n'y pouvant plus tenir, et imaginant qu'elle était partie pour Rouen, il alla sur la grande route, fit une demi-lieue, ne rencontra personne, attendit encore et s'en revint.
Elle était rentrée.
- Qu'y avait-il ?... Pourquoi ?... Explique-moi !...
Elle s'assit à son secrétaire, et écrivit une lettre qu'elle cacheta lentement, ajoutant la date du jour et l'heure. Puis elle dit d'un ton solennel :
- Tu la lires demain ; d'ici là, je t'en prie, ne m'adresse pas une seule question !... Non, pas une !
- Mais...
- Oh! laisse-moi !
Et elle se coucha tout du long sur son lit.
Une saveur âcre qu'elle sentait dans sa bouche la réveilla. Elle entrevit Charles et referma les yeux.
Elle s'épiait curieusement, pour discerner si elle ne soufrait pas. Mais non rien encore. Elle entendait le battement de la pendule, le bruit du feu, et Charles, debout près de sa couche, qui respirait.
- Ah ! c'est bien peu de chose, la mort ! pensait-elle ; je vais m'endormir, et tout sera fini !
Elle but une gorgée d'eau et se tourna vers la muraille.
Cet affreux goût d'encre continuait.
- J'ai soif !... oh ! j'ai bien soif ! soupira-t-elle.
- Qu'as-tu donc ? dit Charles, qui lui tendit un verre.
- Ce n'est rien!... Ouvre la fenêtre..., j'étouffe !
Et elle fut prise d'une nausée si soudaine, qu'elle eut à peine le temps de saisir son mouchoir sous l'oreiller.
- Enlève-le ! dit-elle vivement ; jette-le !
Il la questionna ; elle ne répondit pas. Elle se tenait immobile, de peur que la moindre émotion ne la fit vomir. Cependant, elle sentait un froid de glace qui lui montait des pieds jusqu'au coeur.
- Ah ! voilà que ça commence ! murmura-t-elle.
- Que dis-tu ?
Elle roulait sa tête avec un geste doux pleine d'angoisse, et tout en ouvrant continuellement les mâchoires, comme si elle eût porté sur sa langue quelque chose de très lourd. A huit heures, les vomissements reparurent.
Charles observa qu'il y avait au fond de la cuvette une sorte de gravier blanc, attaché aux parois de la porcelaine.
- C'est extraordinaire ! c'est singulier ! répéta-t-il.
Mais elle dit d'une voix forte :
- Non, tu te trompes !
Alors, délicatement et presque en la caressant, il lui passa la main sur l'estomac. Elle jeta un cri aigu. Il se recula tout effrayé.
Puis elle se mit à geindre, faiblement d'abord. Un grand frisson lui secouait les épaules, et elle devenait plus pâle que le drap où s'enfonçaient ses doigts crispés. Son pouls inégal était presque insensible maintenant.
Des gouttes suintaient sur sa figure bleuâtre, qui semblait comme figée dans l'exhalaison d'une vapeur métallique. Ses dents claquaient, ses yeux agrandis regardaient vaguement autour d'elle, et à toutes les questions elle ne répondait qu'en hochant la tête; même elle sourit deux ou trois fois. Peu à peu, ses gémissements furent plus forts. Un hurlement sourd lui échappa ; elle prétendit qu'elle allait mieux et qu'elle se lèverait tout à l'heure. Mais les convulsions la saisirent ; elle s'écria :
- Ah! c'est atroce, mon Dieu !
Il se jeta à genoux contre son lit.
- Parle ! qu'as-tu mangé ? Réponds, au nom du ciel!
Et il la regardait avec des yeux d'une tendresse comme elle n'en avait jamais vu.
- Eh bien, là..., là !... dit-elle d'une voix défaillante.
Il bondit au secrétaire, brisa le cachet et lut tout haut : Qu'on n'accuse personne... Il s'arrêta, se passa la main sur les yeux, et relut encore.
- Comment!... Au secours ! à moi!
Et il ne pouvait que répéter ce mot: « Empoisonnée ! empoisonnée ! » Félicité courut chez Homais, qui l'exclama sur la place ; Mme Lefrançois l'entendit au Lion d'or; quelques-uns se levèrent pour l'apprendre à leurs voisins, et toute la nuit le village fut en éveil.
Éperdu, balbutiant, près de tomber, Charles tournait dans la chambre. Il se heurtait aux meubles, s'arrachait les cheveux, et jamais le pharmacien n'avait cru qu'il pût y avoir de si épouvantable spectacle.
Il revint chez lui pour écrire à M. Canivet et au docteur Larivière. Il perdait la tête ; il fit plus de quinze brouillons. Hippolyte partit à Neufchâtel, et Justin talonna si fort le cheval de Bovary, qu'il le laissa dans la côte du bois Guillaume, fourbu et aux trois quarts crevé.
Charles voulut feuilleter son dictionnaire de médecine ; il n'y voyait pas, les lignes dansaient.
- Du calme ! dit l'apothicaire. Il s'agit seulement d'administrer quelque puissant antidote. Quel est le poison ?
Charles montra la lettre. C'était de l'arsenic.
- Eh bien, reprit Homais, il faudrait en faire l'analyse.
Car il savait qu'il faut, dans tous les empoisonnements, faire une analyse ; et l'autre, qui ne comprenait pas, répondit :
- Ah! faites ! faites ! sauvez-la...
Puis, revenu près d'elle, il s'affaissa par terre sur le tapis, et il restait la tête appuyée contre le bord de sa couche, à sangloter.
- Ne pleure pas ! lui dit-elle. Bientôt je ne te tourmenterai plus !
- Pourquoi ? Qui t'a forcée?
Elle répliqua :
- Il le fallait, mon ami.
- N'étais-tu pas heureuse ? Est-ce ma faute ? J'ai fait tout ce que j'ai pu pourtant !
- Oui..., c'est ainsi..., tu es bon, toi !
Et elle lui passait la main dans les cheveux, lentement. La douceur de cette sensation surchargeait sa tristesse ; il sentait tout son être s'écrouler de désespoir à l'idée qu'il fallait la perdre, quand, au contraire, elle avouait pour lui plus d'amour que jamais ; et il ne trouvait rien ; il ne savait pas, il n'osait, l'urgence d'une résolution immédiate achevant de le bouleverser.
Elle en avait fini, songeait-elle, avec toutes les trahisons, les bassesses et les innombrables convoitises qui la torturaient. Elle ne haïssait personne, maintenant ; une confusion de crépuscule s'abattait en sa pensée, et de tous les bruits de la terre Emma n'entendait plus que l'intermittente lamentation de ce pauvre coeur, douce et indistincte, comme le dernier écho d'une symphonie qui s'éloigne.
- Amenez-moi la petite, dit-elle en se soulevant du coude.
- Tu n'es pas plus mal, n'est-ce pas ? demanda Charles.
- Non ! non !
L'enfant arriva sur le bras de sa bonne, dans sa longue chemise de nuit, d'où sortirent ses pieds nus, sérieuse et presque rêvant encore. Elle considérait avec étonnement la chambre tout en désordre, et clignait des yeux, éblouie par les flambeaux qui brûlaient sur les meubles. Ils lui rappelaient sans doute les matins du jour de l'an ou de la mi-carême, quand, ainsi réveillée de bonne heure à la clarté des bougies, elle venait dans le lit de sa mère pour y recevoir ses étrennes, car elle se mit à dire :
- Où est-ce donc, maman ?
Et comme tout le monde se taisait :
- Mais je ne vois pas mon petit soulier !
Félicité la penchait vers le lit, tandis qu'elle regardait toujours du côté de la cheminée.
- Est-ce nourrice qui l'aurait pris ? demanda-t-elle.
Et, à ce nom, qui la reportait dans le souvenir de ses adultères et de ses calamités, Mme Bovary détourna sa tête, comme au dégoût d'un autre poison plus fort qui lui remontait à la bouche. Berthe, cependant, restait posée sur le lit.
- Oh ! comme tu as de grands yeux, maman ! comme tu es pâle, comme tu sues !...
Sa mère la regardait.
- J'ai peur ! dit la petite en se reculant.
Emma prit sa main pour la baiser; elle se débattait.
- Assez ! qu'on l'emmène, s'écria Charles, qui sanglotait dans l'alcôve.
Puis les symptômes s'arrêtèrent un moment ; elle paraissait moins agitée ; et, à chaque parole insignifiante, à chaque souffle de sa poitrine un peu plus calme, il reprenait espoir. Enfin, lorsque Canivet entra, il se jeta dans ses bras en pleurant.
- Ah ! c'est vous ! merci ! vous êtes béni mais tout va mieux. Tenez, regardez-la...
Le confrère ne fut nullement de cette opinion, et, n'y allant pas, comme il le disait lui-même, par quatre chemins, il prescrivit de l'émétique, afin de dégager complètement l'estomac.
Elle ne tarda pas à vomir du sang. Ses lèvres se serrèrent davantage. Elle avait les membres crispés, le corps couvert de taches brunes, et son pouls glissait sous les doigts comme un fil tendu, comme une corde de harpe près de se rompre.
Puis elle se mettait à crier, horriblement. Elle maudissait le poison, l'invectivait, le suppliait de se hâter, et repoussait de ses bras roidis tout ce que Charles, plus agonisant qu'elle, s'efforçait de lui faire boire. Il était debout, son mouchoir sur les lèvres, râlant, pleurant, et suffoqué par des sanglots qui le secouaient jusqu'aux talons ; Félicité courait ça et là dans la chambre ; Homais, immobile, poussait de gros soupirs, et M. Canivet, gardant toujours son aplomb, commençait néanmoins à se sentir troublé.
- Diable !... cependant... elle est purgée, et, du moment que la cause cesse...
- L'effet doit cesser, dit Homais ; c'est évident.
- Mais sauvez-la ! exclamait Bovary.
Aussi, sans écouter le pharmacien, qui hasardait encore cette hypothèse : « C'est peut-être un paroxysme salutaire », Canivet allait administrer de la thériaque, lorsqu'on entendit le claquement d'un fouet ; toutes les vitres frémirent, et une berline de poste qu'enlevaient à plein poitrail trois chevaux crottés jusqu'aux oreilles, débusqua d'un bond au coin des halles. C'était le docteur Larivière.
L'apparition d'un dieu n'eût pas causé plus d'émoi. Bovary leva les mains, Canivet s'arrêta court et Homais retira son bonnet grec bien avant que le docteur fût entré.
Il appartenait à la grande école chirurgicale sortie du tablier de Bichat, à cette génération, maintenant disparue, de praticiens philosophes qui, chérissant leur art d'un amour fanatique, l'exerçaient avec exaltation et sagacité ! Tout tremblait dans son hôpital quand il se mettait en colère, et ses élèves le vénéraient si bien, qu'ils s'efforçaient, à peine établis, de l'imiter le plus possible ; de sorte que l'on retrouvait sur eux, par les villes d'alentour, sa longue douillette de mérinos et son large habit noir, dont les parements déboutonnés couvraient un peu ses mains charnues, de fort belles mains, et qui n'avaient jamais de gants, comme pour être plus promptes à plonger dans les misères. Dédaigneux des croix, des titres et des académies, hospitalier, libéral, paternel avec les pauvres et pratiquant la vertu sans y croire, il eût presque passé pour un saint si la finesse de son esprit ne l'eût fait craindre comme un démon. Son regard, plus tranchant que ses bistouris, vous descendait droit dans l'âme et désarticulait tout mensonge à travers les allégations et les pudeurs. Et il allait ainsi, plein de cette majesté débonnaire que donnent la conscience d'un grand talent, de la fortune, et quarante ans d'une existence laborieuse et irréprochable.
Il fronça les sourcils dès la porte, en apercevant la face cadavéreuse d'Emma, étendue sur le dos, la bouche ouverte. Puis, tout en ayant l'air d'écouter Canivet, il se passait l'index sous les narines et répétait:
- C'est bien, c'est bien.
Mais il fit un geste lent des épaules. Bovary l'observa : ils se regardèrent ; et cet homme, si habitué pourtant à l'aspect des douleurs, ne put retenir une larme qui tomba sur son jabot.
Il voulut emmener Canivet dans la pièce voisine. Charles le suivit.
- Elle est bien mal, n'est-ce pas ? Si l'on posait des sinapismes ? je ne sais quoi ! Trouvez donc quelque chose, vous qui en avez tant sauvé !
Charles lui entourait le corps de ses deux bras, et il le contemplait d'une manière effarée, suppliante, à demi pâmé contre sa poitrine.
- Allons, mon pauvre garçon, du courage ! Il n'y a plus rien à faire.
Et le docteur Larivière se détourna.
- Vous partez ?
- Je vais revenir.
Il sortit comme pour donner un ordre au postillon, avec le sieur Canivet, qui ne se souciait pas non plus de voir Emma mourir entre ses mains.
Le pharmacien les rejoignit sur la place. Il ne pouvait, par tempérament, se séparer des gens célèbres. Aussi conjura-t-il M. Larivière de lui faire cet insigne honneur d'accepter à déjeuner.
On envoya bien vite prendre des pigeons au Lion d'or, tout ce qu'il y avait de côtelettes à la boucherie, de la crème chez Tuvache, des oeufs chez Lestiboudois, et l'apothicaire aidait lui-même aux préparatifs, tandis que Mme Homais disait, en tirant les cordons de sa camisole :
- Vous ferez excuse, monsieur ; car dans notre malheureux pays, du moment qu'on n'est pas prévenu la veille...
- Les verres à patte ! ! ! souffla Homais.
- Au moins, si nous étions à la ville, nous aurions la ressource des pieds farcis.
- Tais-toi !... A table, docteur ! Il jugea bon, après les premiers morceaux, de fournir quelques détails sur la catastrophe :
- Nous ayons eu d'abord un sentiment de siccité au pharynx, puis des douleurs intolérables à l'épigastre, superpurgation, coma.
- Comment s'est-elle donc empoisonnée ?
- Je l'ignore, docteur, et même je ne sais pas trop où elle a pu se procurer cet acide arsénieux.
Justin, qui apportait alors une pile d'assiettes, fut saisi d'un tremblement.
- Qu'as-tu ? dit le pharmacien.
Le jeune homme, à cette question, laissa tout tomber par terre, avec un grand fracas.
- Imbécile ! s'écria Homais, maladroit ! lourdaud ! fichu âne !
Mais, soudain, se maîtrisant:
- J'ai voulu, docteur, tenter une analyse, et primo, j'ai délicatement introduit dans un tube...
- Il aurait mieux valu, dit le chirurgien, lui introduire vos doigts dans la gorge.
Son confrère se taisait, ayant tout à l'heure reçu confidentiellement une forte semonce à propos de son émétique, de sorte que ce bon Canivet, si arrogant et verbeux lors du pied-bot, était très modeste aujourd'hui; il souriait sans discontinuer, d'une manière approbative.
Homais s'épanouissait dans son orgueil d'amphitryon, et l'affligeante idée de Bovary contribuait vaguement à son plaisir, par un retour égoïste qu'il faisait sur lui-même. Puis la présence du Docteur le transportait. Il étalait son érudition, il citait pèle-mêle les cantharides, l'upas, le mancenillier, la vipère.
- Et même j'ai lu que différentes personnes s'étaient trouvées intoxiquées, docteur, et comme foudroyées par des boudins qui avaient subi une trop véhémente fumigation ! Du moins, c'était dans un fort beau rapport, composé par une de nos sommités pharmaceutiques, un de nos maîtres, l'illustre Cadet de Gassicourt !
Mme Homais réapparut, portant une de ces vacillantes machines que l'on chauffe avec de l'esprit-de-vin ; car Homais tenait à faire son café sur la table, l'ayant d'ailleurs torréfié lui-même, porphyrisé lui-même, mixtionné lui-même.
- Saccharum, docteur, dit-il en offrant du sucre.
Puis il fit descendre tous ses enfants, curieux d'avoir l'avis du chirurgien sur leur constitution.
Enfin, M. Larivière allait partir, quand Mme Homais lui demanda une consultation pour son mari. Il s'épaississait le sang à s'endormir chaque soir après le dîner.
- Oh! ce n'est pas le sens qui le gêne.
Et, souriant un peu de ce calembour inaperçu, le docteur ouvrit la porte. Mais la pharmacie regorgeait de monde ; et il eut grand peine à pouvoir se débarrasser du sieur Tuvache, qui redoutait pour son épouse une fluxion de poitrine, parce qu'elle avait coutume de cracher dans les cendres ; puis de M. Binet, qui éprouvait parfois des fringales, et de Mme Caron, qui avait des picotements ; de Lheureux, qui avait des vertiges ; de Lestiboudois, qui avait un rhumatisme ; de Mme Lefrançois, qui avait des aigreurs. Enfin les trois chevaux détalèrent, et l'on trouva généralement qu'il n'avait point montré de complaisance.
L'attention publique fut distraite par l'approbation de M. Bournisien, qui passait sous les halles avec les saintes huiles.
Homais, comme il le devait à ses principes, compara les prêtres à des corbeaux qu'attire l'odeur des morts ; la vue d'un ecclésiastique lui était personnellement désagréable, car la soutane le faisait rêver au linceul, et il exécrait l'une un peu par épouvante de l'autre.
Néanmoins, ne reculant pas devant ce qu'il appelait sa mission, il retourna chez Bovary en compagnie de Canivet, que M. Larivière, avant de partir, avait engagé fortement à cette démarche ; et même, sans les représentations de sa femme, il eût emmené avec lui ses deux fils, afin de les accoutumer aux fortes circonstances, pour que ce fût une leçon, un exemple, un tableau solennel qui leur restât plus tard dans la tête.
La chambre, quand ils entrèrent, était toute pleine d'une solennité lugubre. Il y avait sur la table à ouvrage, recouverte d'une serviette blanche, cinq ou six petites boules de coton dans un plat d'argent, près d'un gros crucifix, entre deux chandeliers qui brûlaient. Emma, le menton contre sa poitrine, ouvrit démesurément les paupières ; et ses pauvres mains se traînaient sur les draps, avec ce geste hideux et doux des agonisants qui semblent vouloir déjà se recouvrir du suaire. Pâle comme une statue, et les yeux rouges comme des charbons, Charles, sans pleurer, se tenait en face d'elle, au pied du lit, tandis que le prêtre, appuyé sur un genou, marmottait des paroles basses.
Elle tourna sa figure lentement, et parut saisie de joie à voir tout à coup l'étole violette, sans doute retrouvant au milieu d'un apaisement extraordinaire la volupté perdue de ses premiers élancements mystiques, avec des visions de béatitude éternelle qui commençaient.
Le prêtre se releva pour prendre le crucifix ; alors elle allongea le cou comme quelqu'un qui a soif, et, collant ses lèvres sur le corps de l'Homme-Dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. Ensuite, il récita le Misereatur et l'Indulgentiam, trempa son pouce droit dans l'huile et commença les onctions : d'abord sur les yeux, qui avaient tant convoité toutes les somptuosités terrestres; puis sur les narines, friandes de brises tièdes et de senteurs amoureuses ; puis sur la bouche, qui s'était ouverte pour le mensonge, qui avait gémi d'orgueil et crié dans la luxure ; puis sur les mains, qui se délectaient aux contacts suaves, et enfin sur la plante des pieds, si rapides autrefois quand elle courait à l'assouvissance de ses désirs, et qui maintenant ne marcheraient plus.
Le curé s'essuya les doigts, jeta dans le feu les brins de coton trempés d'huile, et revint s'asseoir près de la moribonde pour lui dire qu'elle devait à présent joindre ses souffrances à celles de Jésus-Christ et s'abandonner à la miséricorde divine.
En finissant ses exhortations, il essaya de lui mettre dans la main un cierge bénit, symbole des gloires célestes dont elle allait tout à l'heure être environnée. Emma, trop faible, ne put fermer les doigts, et le cierge, sans M. Bournisien, serait tombé à terre.
Cependant elle n'était plus aussi pâle, et son visage avait une expression de sérénité, comme si le sacrement l'eut guérie.
Le prêtre ne manqua point d'en faire l'observation ; il expliqua même à Bovary que le Seigneur, quelquefois, prolongeait l'existence des personnes lorsqu'il le jugeait convenable pour leur salut ; et Charles se rappela un jour où, ainsi près de mourir, elle avait reçu la communion.
- Il ne fallait peut-être pas se désespérer, pensa-t-il.
En effet, elle regarda tout autour d'elle, lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un songe ; puis, d'une voix distincte, elle demanda son miroir, et elle resta penchée dessus quelque temps, jusqu'au moment où de grosses larmes lui découlèrent des yeux. Alors elle se renversa la tête en poussant un soupir et retomba sur l'oreiller.
Sa poitrine aussitôt se mit à haleter rapidement. La langue tout entière lui sortit hors de la bouche ; ses yeux, en roulant, pâlissaient comme deux globes de lampe qui s'éteignent, à la croire déjà morte, sans l'effrayante accélération de ses côtes, secouées par un souffle furieux comme si l'âme eût fait des bonds pour se détacher. Félicité s'agenouilla devant le crucifix, et le pharmacien lui-même fléchit un peu les jarrets, tandis que M. Canivet regardait vaguement sur la place. Bournisien s'était remis en prière, la figure inclinée contre le bord de la couche, avec sa longue soutane noire qui traînait derrière lui dans l'appartement. Charles était de l'autre côté, à genoux, les bras étendus vers Emma. Il avait pris ses mains et il les serrait, tressaillant à chaque battement de son coeur, comme au contrecoup d'une ruine qui tombe. A mesure que le râle devenait plus fort, l'ecclésiastique précipitait ses oraisons ; elles se mêlaient aux sanglots étouffés de Bovary, et quelquefois tout semblait disparaître dans le sourd murmure des syllabes latines, qui tintaient comme un glas de cloche.
Tout à coup, on entendit sur le trottoir un bruit de gros sabots, avec le frôlement d'un bâton ; et une voix s'éleva, une voix rauque, qui chantait :
Souvent la chaleur d'un beau jour
fait rêver fillette à l'amour.
Emma se releva comme un cadavre que l'on galvanise, les cheveux dénoués, la prunelle fixe, béante.
Pour amasser diligemment
Les épis que la faux moissonne
Ma Nanette va s'inclinant
Vers le sillon qui nous les donne.
- L'Aveugle ! s'écria-t-elle.
Et Emma se mit à rire, d'un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face hideuse du misérable, qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement.
Il souffla bien fort ce jour-là
Et le jupon court s'envola
Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s'approchèrent. Elle n'existait plus.
Source:http://pagesperso-orange.fr/jb.guinot/pages/mortBovary.html

EFFETS INGESTION ARSENIC
L’intoxication par l’Arsenic tue par inhibition allostérique des enzymes indispensables au métabolisime, conduisant à la mort par défaillance organique multiple. Il inhibe principalement les enzymes exigeant la présence d'acide lipoïque comme cofacteur, tels que la pyruvate et l'alpha-ketoglutarate déshydrogénase. Pour cette raison, les substrats produits avant l’étape de la déshydrogénase comme le pyruvate (et le lactate) s'accumulent. Il affecte en particulier le cerveau, provoquant des troubles neurologiques et la mort.
Symptômes
Les symptômes comprennent de violentes douleurs abdominales dues à des spasmes intestinaux; une sensibilité et une tension de l’abdomen; des nausées; une salivation excessive; vomissements; une sensation de sécheresse et de constriction de la gorge, de la soif, une raucité de la voix et des difficultés de la parole, les vomissures sont verdâtres ou jaunâtres, parfois striées de sang; une diarrhée, du ténesme; parfois des excoriations de l'anus; une atteinte de l’appareil urinaire est possible avec de violentes douleurs à type de brûlures; des convulsions et des crampes; des sueurs froides; des lividités des extrémités; des traits tirés; des yeux rouges et brillants; puis le délire et la mort. Certains de ces symptômes peuvent être absents lorsque l'intoxication est la conséquence d’une inhalation, sous forme de trihydrure d'arsenic.
Les symptômes de l'empoisonnement par l'arsenic débutent insidieusement avec des céphalées et peuvent s’aggraver avec apparition d’étourdissements et, en général si la maladie n'est pas traitée, aboutir à la mort.
L'empoisonnement par l'arsenic peut provoquer une grande variété de troubles, allant du cancer de la peau à l’hyperkératose des pieds
Source:http://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication_%C3%A0_l%27arsenic
Cette images représente les mains d'une personne empoisonnée à l'arsenic