Paul Clavier, La fourmi n'est pas prêteuse. Conversations impertinentes sur l'argent, 2015, lu par Lucas Scrive
Par Jérôme Jardry le 29 mai 2015, 06:00 - Philosophie politique - Lien permanent
 Paul Clavier, La fourmi n'est pas prêteuse. Conversations impertinentes sur l'argent, Salvator, Paris, 2015, 142 pages.
Paul Clavier, La fourmi n'est pas prêteuse. Conversations impertinentes sur l'argent, Salvator, Paris, 2015, 142 pages.
Le banquier Desprez surprend Tozzero, une jeune stagiaire, en train de travailler à l'écriture d'un dialogue sur l'argent au lieu de s'occuper de ses dossiers. Tozzero doute, au vu de l'ampleur de la crise économique actuelle, de la légitimité des banques – rien que ça – forçant ainsi Desprez, idéalement placé pour servir de sparring-partner, à se faire l'avocat du diable. Après quelques escarmouches cocasses et sans conséquences, s'ensuit un dialogue à bâtons rompus sur la création monétaire, son rôle dans la crise que nous traversons et le monde du « tout-à-crédit » et de la dette qui est désormais le nôtre. Très vite les questions essentielles sont posées : « Qu'est-ce que l'argent ? En quoi consiste la création monétaire ? À qui profite vraiment le crédit ? » (p. 33).
C'est d'abord la question de la création monétaire par les banques qui rythme les échanges entre Desprez et Tozzero. Le lecteur qui ignore la véritable nature de l'argent dans les sociétés modernes doit se préparer à un choc. Si seules les banques centrales (la Banque de France hier, la Banque centrale européenne aujourd'hui) ont le pouvoir d'émettre les billets de banque que nous manions au quotidien, ce sont les banques commerciales, à travers l'émission de crédit, qui créent l'essentiel de l'argent circulant dans les échanges économiques.
Les banques ne
se contentent pas en effet d'encaisser l'argent des déposants pour le prêter à
d'autres : elles démultiplient la monnaie en circulation au moyen d'un
système aujourd'hui considéré comme parfaitement légal – le système des
réserves fractionnaires. Lorsque je dépose 100 € sur un compte courant, la
banque ne se contente pas de conserver pour mon compte la somme déposée :
si elle me garantit bien la possibilité de retirer la somme à tout moment (on
parle alors de dépôt à vue), la banque part de l'hypothèse que je ne
réclamerai pas cette somme immédiatement après l'avoir déposée et elle en prête
donc la plus grande partie, mettant en réserve ce qui reste (disons 10 %
de la somme) : c'est ce qu'on appelle la réserve légale (dont le taux
avoisine en réalité aujourd'hui les 0,01 % !). Jusque là, la banque a
simplement servi d'intermédiaire financier. L'argent du déposant n'est pas
conservé par la banque mais prêté et la banque se rémunère grâce à l'intérêt
qu'elle touche sur ce prêt.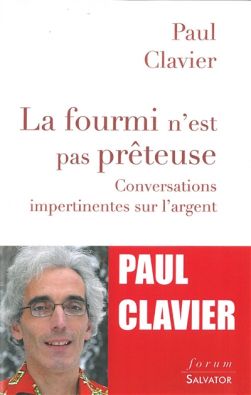
C'est en suivant le parcours des 90 € prêtés par la banque à un entrepreneur de ses clients qu'apparaît le mécanisme de création monétaire proprement dit. Les 90 € que la banque prête à cet entrepreneur prennent la forme d'un dépôt pour le même montant dans le bilan de l'établissement financier : un montant de 90 € est transféré sur le nouveau compte créé par l'emprunteur ou ajouté à son compte. La banque va alors à nouveau mettre en réserve 10 % de ce montant et en prêtant 90 % (soit 81 €) et ainsi de suite jusqu'au terme du processus. En parfaite application de la loi sur le taux de réserve légale, un banquier peut ainsi créer à partir d'un montant de 100 € pour 1000 € d'encaisses sous la forme de lignes de code. Le banquier pour rémunérer ses services peut donc compter, non pas sur les intérêts d'une somme de 90 €, mais sur ceux d'un montant total de prêts de 900 €… Dans ses conditions, on comprend que les justifications de cette création monétaire ex nihilo qui profite à plein au banquier ont intérêt à être bonnes et nombreuses.
C'est justement ce qui inquiète Tozzero qui se demande ce qui légitime que les banquiers puissent réaliser de tels gains. Le banquier convertit une dette (la ligne de crédit ouverte au profit d'un emprunteur) en argent qu'il prête à nouveau, démultipliant ainsi la quantité de monnaie circulant dans l'économie. N'est-ce pas là le mal à la racine de la crise actuelle : si les banquiers peuvent faire fortune en transformant des dettes en signes monétaires, n'ont-ils pas intérêt à prêter au maximum et à n'importe qui ? N'est-ce pas là l'origine de la hausse continue des prix de l'immobilier quand tout le monde ou presque peut désormais emprunter sur vingt ans ? N'est-ce pas là encore l'origine de la hausse des titres financiers et de la spéculation boursière aggravant les inégalités entre les pauvres et les riches ? N'est-ce pas là enfin, l'origine à la fois du surendettement des ménages et du creusement des dettes souveraines quand les banquiers gagnent à prêter aux États ?
Tozzero s'avoue séduite par le plan de réforme proposé suite à la crise des années 30 par Irving Fisher qui proposait de séparer l'activité de prêt et l'émission monétaire en forçant les banques à opérer avec un coefficient de 100 % de réserves. Toute création monétaire par les banques serait ainsi empêchée : seuls le gouvernement ou la banque centrale auraient alors le pouvoir d'augmenter la quantité de monnaie en circulation si cela est nécessaire. Il n'y aurait pas davantage d'euros crédités sur les comptes bancaires que d'euros circulant sous forme de billets de banque.
Desprez n'est pas impressionné, renvoie Fisher et Allais dans les cordes, considère que vouloir limiter les prêts d'argent à l'encaisse disponible est utopique, et fait valoir que l'activité de prêt est essentielle à l'activité économique qu'il juge dépendante de la confiance des ménages, confiance qui repose selon lui sur la facilité d'accès au crédit. À Tozzero qui se demande si « l'endettement structurel est une bonne chose ? » et si « le tout-à-crédit est un véritable levier de croissance ? » (p. 38), Desprez répond que l'histoire du développement économique est indissociable de l'histoire du prêt d'argent et de l'intérêt. Le banquier prend le parti de la cigale de Jean de La Fontaine et critique la fourmi de lui avoir claqué la porte au nez. Tozzero renâcle, ne croit pas qu'on puisse fabriquer de la richesse avec des signes virtuels mais que la richesse repose sur le travail, que c'est l'économie « réelle » qu'il faut encourager et stimuler. Desprez trouve l'argument abstrait, pense que c'est une illusion de ne croire qu'à « la monnaie sonnante et trébuchante » et que les banques centrales ne doivent pas s'immiscer dans le libre jeu de la demande des prêts et qu'il est légitime que les banques soient rémunérées pour ce service. Les deux protagonistes examineront alors successivement la question de la légitimité du prêt à intérêt, sa condamnation par l'Église et l'antisémitisme qui s'est nourri de cette condamnation à travers la lecture du Marchand de Venise de Shakespeare et de son banquier juif, Shylock avant de reprendre à nouveaux frais la question centrale…
La question de la légitimité de la création monétaire par les banques est une question aussi austère en apparence qu'essentielle pour notre temps. Et ce n'est pas la moindre qualité de l'ouvrage de Paul Clavier que de réussir à poser clairement les termes du débat, et de façon enlevée et brève, sans rien sacrifier à la rigueur des arguments. On est loin ici de la « science lugubre » dont parlait Carlyle et ces conversations sur l'argent contiennent tout le culot et l'impertinence requises pour intéresser le lecteur le plus réticent à se passionner pour la chose monétaire et bancaire. Si le choix du dialogue sert grandement les desseins de l'auteur, il faut souligner qu'il s'agit bien ici d'un véritable dialogue et pas d'un jeu de massacre : Desprez le banquier sait encaisser les coups et il sait en donner. C'est aussi un homme de culture, soucieux de ne pas entraver une prospérité économique qu'il juge profitable à tous – un honnête homme en somme, loin du banquier véreux des caricatures faciles.
Les références sur lesquelles l'auteur s'appuie sont également bienvenues et précises. Originales et iconoclastes aussi : si Keynes ou Stiglitz sont cités, Irving Fisher ou encore le prix Nobel français Maurice Allais sont conviés à la table des débats. Sans oublier des penseurs comme Calvin ou encore l'héritage des scolastiques et de Saint Thomas d'Aquin lorsque la question de la légitimité du prêt à intérêt et de l'usure est abordée. C'est d'ailleurs sans doute ici la grande qualité du livre – et celle qui intéressera le plus le philosophe – que de montrer à quel point la question de la création monétaire est une question foncièrement morale et politique et non une simple question technique. Si les bienfaits économiques traditionnellement avancés pour justifier cette création monétaire par les banques sont illusoires – ce que suggèrent la succession des crises économiques actuelles ou encore l'état des dettes souveraines –, et entraînent de graves conséquences morales, sociales et spirituelles, n'est-il pas alors nécessaire de revoir de fonds en comble le rôle des banques ? Et si oui, comment faire aboutir de telles réformes sans reprendre l'analyse, à la suite d'Aristote ou des scolastiques, de ce qu'est l'argent et de ce qu'est la valeur ? [1]
Le livre une fois refermé, le lecteur éprouvera peut-être une forme d'inconfort à prendre position en faveur de l'un ou l'autre des protagonistes sur la base des arguments échangés. Ces arguments sont en effet une invitation à prolonger l'analyse – analyse qui débordait évidemment les cadres de l'ouvrage. Reste qu'on peut avoir parfois le sentiment que Tozzero accorde à son adversaire trop facilement certains points et qu'il y avait d'autres arguments à faire valoir. En particulier, l'idée qu'il puisse exister un ordre monétaire naturel qui ne nécessite aucune banque centrale sans pour autant conduire à la création monétaire illimitée que nous connaissons de nos jours –peu ou prou le système traditionnel de l'étalon-or– n'est pas véritablement analysée. Cet argument plairait sans doute à Tozzero et il déplairait sans doute moins à Desprez car le prêt à intérêt y conserverait toute sa place. Mais c'est sans doute une force du livre de Paul Clavier que de faire ainsi ressentir à son lecteur le vertige et les richesses de cette question renouvelée du prêt à intérêt dans un monde dominé par la dette et le crédit.
[1] Pour une présentation classique de l'apport des scolastiques à la théorie économique et de leur conception de la place de l'analyse économique comme branche du savoir, voir Raymond De Roover, La pensée économique des scolastiques. Doctrines et méthodes, Vrin, Paris, 1971. Pour une analyse détaillée des effets moraux, sociaux et spirituels de la création monétaire par les banques, voir Jorg Guido Hülsmann, L'éthique de la production de monnaie, L'Harmattan, Paris, 2010.
Lucas Scrive