Jean Vioulac, Apocalypse de la vérité, Ad Solem, 2014 – lu par Ugo Batini
Par Baptiste Klockenbring le 14 janvier 2015, 06:00 - Métaphysique - Lien permanent
 C’est dans le contexte agité de
la publication des Carnets Noirs que
paraît aux éditions Ad Solem le dernier ouvrage de Jean Vioulac qui semble
venir achever une trilogie commencée chez Epiméthée (PUF) par L’époque de la technique et La logique totalitaire. Si Apocalypse de la vérité peut très bien
se lire seul, il est clair cependant qu’il prendra toute sa mesure dans la
prolongation des deux premiers essais puisqu’il semble en constituer une sorte
de conclusion voire de récapitulation. C’est donc un parcours herméneutique
complet de la pensée de Heidegger qui finalement se dessine au fil de ces
livres.
C’est dans le contexte agité de
la publication des Carnets Noirs que
paraît aux éditions Ad Solem le dernier ouvrage de Jean Vioulac qui semble
venir achever une trilogie commencée chez Epiméthée (PUF) par L’époque de la technique et La logique totalitaire. Si Apocalypse de la vérité peut très bien
se lire seul, il est clair cependant qu’il prendra toute sa mesure dans la
prolongation des deux premiers essais puisqu’il semble en constituer une sorte
de conclusion voire de récapitulation. C’est donc un parcours herméneutique
complet de la pensée de Heidegger qui finalement se dessine au fil de ces
livres.
L’époque de la technique avait su mettre en place une pensée concrète du phénomène technique qui révélait alors nettement les liens entre la pensée de Heidegger et celle de Marx en reprenant par exemple dans le détail la question de la machination et son expression éclatante que finit par constituer le capitalisme. C’est en repartant de cette base que La logique totalitaire a su pousser encore plus loin le projet philosophique de Jean Vioulac en lui donnant une perspective plus large que son sous-titre ne manque pas de souligner : « Essai sur la crise de l’Occident ». Le « Dispositif planétaire » que constitue la technique nous met face à un bouleversement inédit et nous impose de réinterroger l’entreprise même de la philosophie pour y déceler la part de son implication dans un tel mouvement. Reprenant les analyses heideggériennes sur l’origine grecque de la philosophie, J. Vioulac cherche alors à montrer à travers l’analyse de la notion de totalité comment la philosophie a participé à une logique qui ne pouvait que déboucher sur une victoire totale du principe de raison et donc sur une rationalisation omniprésente de toutes choses y compris dans un cadre pratique et politique. C’est à prendre la mesure d’une telle hégémonie que s’attache alors Apocalypse de la vérité qui arrive pour repenser la conclusion de ces deux ouvrages et tenter de percevoir derrière le constat amer du développement généralisé d’une technologie à tous les niveaux de l’humain ce qu’il est possible désormais d’attendre de la pensée mais aussi plus largement de l’homme.
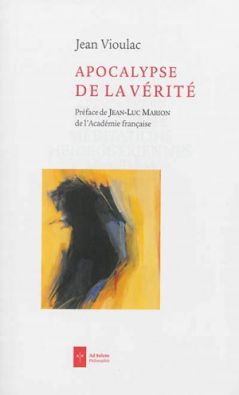
C’est donc un parcours complet, au plus proche de la pensée de Heidegger cette fois-ci, que nous offre l’auteur en suivant comme fil directeur la question de la vérité. Puisqu’il s’agit de déterminer le rôle même que la pensée peut tenir face aux désastres décrits dans les précédents ouvrages, le premier chapitre va tout naturellement s’interroger sur l’activité philosophique et la caractériser par un souci de clairvoyance. Si l’ignorance est bien quelque chose que la pensée doit dépasser, c’est plus du côté de la fascination qu’exerce l’objectivité du savoir que se situe pour elle le véritable danger. L’aveuglement paradoxal qu’une telle connaissance suscite est beaucoup plus difficile à surmonter d’où la nécessité de s’interroger sur les ressorts de notre propre vision. La clairvoyance est garantie par la pureté de la vision comme le montrent bien les efforts de la méditation cartésienne dont le fameux critère de l’évidence peut être perçu comme une « vision du voir ». Mais « cette vue du visible » ne suffit pas pour cerner la totalité du processus qui constitue notre connaissance. Si l’on file la métaphore de la vision, il ne faut pas négliger le rôle de la lumière puisque c’est par elle que la vision et le visible peuvent être mis en relation. C’est précisément l’apport décisif de Heidegger de risquer ce nouveau pas en arrière et de mettre au jour une forme de naïveté ontologique à se fonder sur ces évidences sans interroger ce qui les conditionne. Il devient alors nécessaire de radicaliser à l’extrême la réduction transcendantale en remontant en-deçà même de la subjectivité pour découvrir le milieu de phénoménalité en lequel l’existence du sujet se donne. C’est ce milieu que Heidegger va penser comme « être », mais aussi comme « Ouvert » ou « Éclaircie ». Il s’agit donc ni plus ni moins que de penser cet espace qui porte toute métaphysique, et toute science à sa suite, afin de devenir - au sens propre - lucide (en tant que nous cherchons à voir cette lumière). Mais cette lucidité exige nécessairement de renoncer à l’évidence comme mesure de la pensée et de revenir à la condition de possibilité de toute apparition en remettant en cause la suffisance même de l’ego en cherchant précisément la faille qui est en lui. Mais surtout cette prise en compte d’une nouvelle position sur l’être ne peut se faire qu’en élargissant l’analyse à l’événement même de son histoire. C’est ce changement d’échelle qui va nous imposer de penser notre époque afin de circonscrire le site fondamental en lequel nous nous tenons.
Le chapitre 1 a donc bien posé le cadre dans lequel le problème se situe et nous voyons bien en quels sens il dépasse largement la simple critique de la technique telle qu’elle a pu être exposée dans L’époque de la technique. Il y quelque chose de plus radical qui est en jeu et qui va amener l’auteur à reprendre avec Heidegger l’histoire même de la pensée métaphysique, mais aussi de tenter d’entrapercevoir le régime de phénoménalité propre à notre époque. Il suffit pour cela de saisir comment celle-ci met en forme les traits de chaque étant. Ainsi l’analyse d’un simple étant naturel comme le soleil montre les métamorphoses qu’il a pu subir au sein de la pensée de l’homme puisque de « Dieu parfait et bien-aimé » chez les Egyptiens, il devient par exemple, pour nous, une sphère de gaz en fusion et est finalement perçu comme une machine à produire de l’hélium. C’est son essence machinique qui prime désormais et cela se confirme dans l’analyse du vivant comme « corps machine » ou de l’homme comme « machine désirante ». La science contemporaine déploie de façon inconditionnée le règne de la causalité et aborde donc le tout à partir de l’a priori de son essence machinative. Ce mode de déploiement de l’essence (compris alors comme essance dans certaines traductions), qui impose à tout ce qui est la configuration de la machine, est alors ce qu’il faut nommer la « machination » (die Machenschaft). Ainsi nous comprenons que l’époque de la technique n’est pas qualifiée ainsi par la démultiplication des machines mais par le fait qu’elle déploie un régime de phénoménalité propre qui pense tout - y compris la pensée elle-même - comme machine. Cette démultiplication du calcul comme assise ontologique principale fait que la fameuse éclaircie que nous cherchions prend la forme d’un « marché mondial » dominé tout entier par la puissance calculante de la machination et dont le flux permanent d’informations entraîne une dissolution de l’humain à tous les niveaux, dont la création de masses au détriment des peuples n’est malheureusement qu’un des exemples les plus visibles.
La puissance de cette machination est détaillée au chapitre 2 qui souligne nettement l’importance de la relation causale qui peut se comprendre d’ailleurs comme le cœur de la pensée de la régulation cybernétique de la Machinerie. Mais ce gigantesque fonctionnement ne mène à rien si ce n’est à sa propre circularité et à la volonté de développer de la puissance pour la puissance. Ce système fonctionne donc sur une mise en pièces de tout étant en vue de son intégration dans la Machine. Cette réduction est précisément ce que Heidegger dénomme appareillement (Die Gleichmachung). Cette indifférenciation de tout ce qui est est un moyen de se fermer définitivement à l’être, à l’autre, pour ne trouver toujours que le même. C’est un tel mécanisme que l’on trouve dans le projet de mathématisation de la nature qui vise, par le recours aux mathématiques, à une forme d’autonomisation de la rationalité. On comprend alors pourquoi « l’époque de la technique » est donc bien la domination totale du principe de raison qui repose ultimement sur l’ « amêmement » (néologisme proposé par F. Fédier pour rendre Ereignis dans sa traduction des Beiträge) de l’être et du logos et forme une onto-logie constituant ainsi de fait un moment d’achèvement de la métaphysique puisqu’elle en est sa mise en œuvre littérale.
Si l’on reprend cette histoire, il est facile de constater, avec Heidegger, que la définition même de la vérité a toujours été comprise, comme lien, correspondance, adéquation (etc.) entre pensée et réalité et donc finalement étant et logos. Mais le moment grec est aussi l’événement d’un oubli premier qui consiste à « mettre à l’écart » toute altérité, à la renvoyer dès le départ dans l’impensé. Ainsi il s’impose à nous de penser à la fin de cette histoire ce qui a été oublié à son commencement. Il faut saisir le fond sur lequel l’éclaircie de la vérité se dévoile. Cette vérité (aléthéia) est seconde par rapport au fond obscur qu’elle s’efforce d’oblitérer. Il y a donc une essance adversative à la vérité irréductible au faux, qui est ce contre quoi elle s’instaure, et qui s’étend au-delà de la lisière de son éclaircie.
Mais la pensée de ce « différend originel » impose de complexifier la topologie de l’Être et c’est précisément ce que vise à dessiner le chapitre 3. La question ontologique cruciale devient alors de déterminer quelle est l’origine de l’Eclaircie. L’avènement de l’être au sein de l’étant procède d’une béance. Heidegger use de la graphie Seyn pour penser l’abîme en tant qu’origine de l’être (Sein). Ainsi la réduction phénoménologique qu’il opère reconduit dans un premier temps de l’étant à l’être, et dans un second temps de l’être à l’Être. Ce dernier mode se signale précisément en disparaissant. Toujours prompt à l’étymologie, il rapproche ce mouvement du verbe grec muo (« se fermer », « se clore ») et pense ainsi l’essance originaire de la vérité comme mystère. Là encore un tel rapport au mystère est le lot commun de tous les mortels. La mort est bien un phénomène dont l’apparition est disparition. A partir de là, on comprend que la vérité est un certain comportement par rapport au mystère que l’on capte dans sa volonté de fixer sa pensée de façon unilatérale sur l’étant et son étantité tout en barrant tout accès à son origine essantielle. Ainsi le commencement de l’histoire occidentale est un oubli et il est difficile d’imaginer l’ampleur de ce qui est resté hors de prise du logos grec et qui est depuis toujours « hors de question » pour la philosophie. C’est donc dans la poésie, et en particulier dans les poèmes fluviaux de Hölderlin, que Heidegger va se tourner pour méditer l’énigme de l’origine. Il s’agit désormais de ne plus tomber dans l’errance dans laquelle nous enferme la conception traditionnelle de la vérité qui se fixe sur les étants sans voir le milieu qui est à leur origine.
A l’ombre de cette histoire de l’être qui se révèle être le destin de l’Erreur, le danger de la machination et le risque de l’annihilation n’ont plus rien de contingents. La lucidité qui devait être visée par la probité philosophique prend face à cela la forme d’un effroi. La tâche de la pensée ne peut plus consister qu’à refondre la vérité plus originairement que les Grecs, c’est-à-dire re-commencer l’histoire plus originairement afin de donner droit à la phénoménalité paradoxale du mystère.
Tout le problème - et c’est à partir de là aussi que l’ouvrage demande une forme de saut - c’est que l’espace de pensée que nous laisse la machination rend impossible l’accès au mystère. Il ne peut donc relever des hommes mais ne peut advenir que comme un événement. Plus précisément, il ne peut qu’être révélé mais cette révélation ne peut advenir que comme une catastrophe. Cet événement est précisément ce que circonscrit le concept d’apocalypse qui sera au cœur du quatrième chapitre.
Etymologiquement, le mot renvoie à l’idée d’un dévoilement, la mise au jour de ce qui était auparavant invisible. Ce dévoilement ne découvre pas la nature mais le mystère - il est donc un mode de manifestation incommensurable à l’aléthéia. C’est dans la pensée de Saint Paul que Heidegger trouve une première impulsion pour penser un nouveau cheminement. Il y a dans les textes pauliniens déjà une confrontation entre la tradition hébraïque et la pensée hellénique qui se situe autour de la portée de ce mystère et de son rapport au concept de vérité. Il ouvre sur quelque chose qui échappe précisément à toute pensée du logos et qui pourtant met au jour ce que le monde cache. Le corps même du Christ est pensé comme l’incarnation d’un tel mystère et impose de penser les limites de la phénoménalité qu’impose la sagesse grecque. Heidegger pense alors la tâche de l’Apôtre comme rejet de l’identité de l’être et du logos. Il est là pour nous révéler la finitude d’une « vérité captive » en l’ouvrant soudainement à « toute la vérité » par la reconnaissance de la phénoménalité propre au mystère. Il éclaire ainsi les carences du fondement grec qui en frappant d’interdit la voie du néant dans le poème de Parménide ampute la vérité et pose les ferments d’un nihilisme à venir.
Le chapitre 5 nous confronte logiquement au devenir d’un tel commencement en détaillant ce qu’il est devenu à notre époque. Proche des analyses de L’époque de la technique, il revient sur la nature du risque que la technique nous fait encourir en montrant bien qu’il ne se limite pas à une annihilation effective et totale. Là encore le concept d’apocalypse nous permettra de mieux cerner ce qui est en jeu et en particulier nous permettra de saisir l’ampleur de la catastrophe qu’a pu constituer Auschwitz. Loin d’être une anomalie, ce n’est ni plus ni moins que l’Occident en son essance qui a été mis au jour dans cet événement. La pensée doit donc œuvrer à se ressaisir en cherchant à déterminer ce qui a pu mener à une telle issue, même si elle est fragilisée face à l’emprise planétaire de la machination qui cherche à la réduire à un simple calcul.
On comprend alors que cet effondrement implique la fondation d’une tout autre vérité. Cette dernière sera le fruit d’une création qui se jouera sur le refus de la vérité existante et qui donc cherchera à puiser dans cette réserve abyssale sur laquelle s’est fondée l’éclaircie. Cette refondation sera le fait de créateurs capables de mettre en forme des éléments de cet abîme. L’œuvre d’art et en particulier le discours poétique sont des exemples de telles concrétions. L’artiste est tout entier tourné vers l’instauration d’une telle vérité. Or celle-ci se dit essentiellement dans le langage d’où le rôle encore plus central du poète. Ainsi le seul moyen d’inaugurer un autre Commencement doit passer par l’événement inaugural de la poésie. Le poète devient alors prophète.
C’est sur cette ouverture que va alors faire fond le dernier chapitre (chapitre 6) qui cherche bien à confronter la philosophie à ses propres limites en retournant la pensée vers ce néant qui a été originairement et volontairement neutralisé par le logos, et oublié. Il s’agit de dire « le tout autre » et la tâche du penseur ne sera rien d’autre que de frayer la voie pour la parole du poète. Si le vocabulaire utilisé (« Prophète », « Salut » etc.) peut laisser entendre une solution de repli vers la foi, il n’en est rien surtout à une époque où la « dédivinisation » est accomplie. L’athéisme de notre époque n’est là encore pas superficiel mais inhérent à son essance. Tout comme Nietzsche, c’est plutôt dans Hölderlin que Heidegger semble entendre la voix capable de nous amener à la conscience de nos errements. Il est, à ses yeux, le prophète essentiel de notre temps et son œuvre est le lieu de la « révélation de l’Être ». Il retrouve dans ses poèmes fluviaux de quoi ressaisir notre destin en comprenant l’essance de son histoire. Le mouvement antagoniste que le fleuve subit entre sa fermeture dans sa source et son épanchement vers le delta permet de lire la tension propre à la pensée grecque prise elle-aussi entre l’Oriental et l’Occidental, le pathos et le logos. C’est une illusion qui nous faire voir l’aurore de la Grèce dans le rayonnement des Lumières. La force du logos que cette pensée déploie ne visait qu’à supporter l’illimité et non à le fuir. Mais à la vue de notre situation, force est de constater que l’autonomie conquise par le concept n’est pas un épanouissement mais une catastrophe car il a mené à une rupture avec ce qui nous nourrissait auparavant. Notre effort spirituel doit être renversé pour retrouver le chemin de cette source et le travail du poète est de dénommer cet originaire. Ce n’est donc pas un hasard si la fin de l’itinéraire de Hölderlin se concentre sur le rapport entre la langue et le divin et en particulier derrière celui-ci le rôle effectif du silence.
Puisque l’homme n’est plus en mesure de déjouer cette catastrophe par lui-même, il ne lui reste plus qu’à attendre l’advenue d’un événement qui se concrétisera selon les Beiträge par l’idée du « passage du dernier dieu ». C’est en réfléchissant dans son premier cours sur Hölderlin la question de l’a-théisme de Nietzsche qu’il comprend à quel point il est un point de passage nécessaire pour accéder à une vraie compréhension du divin qui ne le réduit pas à être un simple ressort métaphysique en tant que causa sui ou fondement de valeurs. Cela ne peut donc qu’amener le dernier paragraphe du chapitre 6 à poursuivre une longue méditation sur le mode d’être du dieu et le rôle qu’y joue son abstention.
Le manque du Dieu est peut-être le rapport le plus authentique que l’on peut aujourd’hui avoir au divin en tant que le manque est « non pas l’absence de dieu, mais son entrée en présence ». On comprend alors mieux pourquoi le silence peut sembler la parole la plus susceptible d’accueillir une telle absence. Ce silence n’est alors pas négation du discours mais se découvre comme son fondement en tant qu’il est écoute de cette absence fondatrice du divin. Il n’est alors pas étonnant de voir le trajet de Heidegger abandonner un moment Hölderlin pour chercher chez Maître Eckhart les moyens de penser ce qui pour la logique classique est déjà un paradoxe. Le choix de ce dernier est loin d’être innocent car, tout philosophe qu’il est, il reste néanmoins aussi un poète qui a su configurer de façon décisive la langue allemande en créant par ses prédications la plus grande part de son vocabulaire philosophique. C’est d’ailleurs le terme central de « déité » qui va retenir toute l’attention de Heidegger en tant qu’il désigne la profondeur intacte, car inaccessible, de Dieu. Approcher la déité, c’est donc expressément renoncer à tout concept, à toute image et donc finalement à tout discours. Le cheminement d’Eckhart, et en particulier son explication serrée avec l’Ecriture, l’amène à repenser la question du Néant et, à travers elle, à défaire l’ontothéologie classique. Le « Néant » devenant la dénomination la plus propre de la déité, c’est désormais dans un travail sur l’âme, dans l’approfondissement de notre propre fragilité, qu’Eckhart pense la possibilité d’une réception de la lumière divine et la comprend à travers la figure même du Christ qui devient, dans sa souffrance même, prophète au sens où Heidegger redéfinit ce terme à partir de Hölderlin. Or ce qu’apporte le Christ en tant que prophète c’est précisément le nom du Père comme dénomination de la déité : « Je leur ai fait connaître ton nom » (Jean, XVII, 26). C’est à partir d’un tel acte - le passage du dernier Dieu - que peut se comprendre la possibilité d’un nouveau commencement et l’instauration d’une « tout autre vérité », comprise comme sauvegarde du mystère. On voit alors comment peuvent se comprendre les histoires de ces commencements. Depuis Parménide, toute la pensée métaphysique a fermé la « voie » du Néant ; depuis Saint Paul, toute la pensée chrétienne voit dans le Christ une telle « voie », une « porte » entre l’abîme originaire et le monde qui en est surgi, entre la déité et les hommes.
Et ainsi, à l’extrême fin de son ouvrage, J. Vioulac délaisse finalement l’exposé très fidèle qu’il a fait du cheminement de la pensée de Heidegger pour le réfléchir et préciser ce qu’est finalement ce nouveau commencement. Cette mise à distance du texte original passe en grande partie par la réévaluation de l’impact de la figure du Christ qui devient un événement inaugural au même titre que « l’Amêmement » ontologique. Et il devient alors possible d’objecter à Heidegger que l’ « autre Commencement » a déjà eu lieu. On ne peut que regretter la rapidité des explications, surtout après les longs développements des premiers chapitres sur des éléments plus connus de la doctrine de Heidegger, car le nouveau chemin qu’il dégage en méditant la question du temps est intéressante. Il part en effet de l’idée qu’un autre commencement ne peut advenir qu’en dehors de la temporalité constitutive de l’histoire du premier Commencement. L’autre histoire, celle de la sauvegarde du sacré, ne prend pas la suite de la première sur la même ligne chronologique, mais se déploie autrement et conformément à la méditation augustinienne on peut alors affirmer qu’elles « avancent ensemble, enchevêtrées l’une dans l’autre » (Cité de Dieu, I, 35). Mais cet entrelacement rend du coup d’autant plus problématique la fermeture de la totalité sur elle-même que représente l’événement d’Auschwitz. Le XXème siècle impose donc le renoncement à l’idée d’un Dieu seigneur de l’histoire, et l’abandon de la thèse d’une providence divine mais il impose tout autant le devoir de penser ce qui se révèle dans l’apocalypse d’Auschwitz. C’est à partir de ce nœud que J. Vioulac décide de terminer son cheminement avec la pensée de Hans Jonas qui précisément tente bien dans son œuvre de repenser le rapport de Dieu et de l’histoire du monde à travers une recompréhension de la notion même de Dieu qui passe par une méditation sur le concept de toute puissance. La création est le fruit d’un acte d’autodessaisissement du divin qui s’est au sens propre « dépouillé en faveur du monde » (Le Concept de Dieu après Auschwitz). On arrive alors à la figure d’un Dieu qui passe sous la garde problématique de l’homme afin d’accéder pleinement à sa propre expérience. Il saura alors pleinement ce qu’il est à la fin, c’est-à-dire au temps de l’apocalypse. Cette logique est déjà celle pleinement à l’œuvre dans la révélation chrétienne où Dieu s’est abaissé lui-même dans le corps du Christ pour faire de l’impuissance radicale et pathétique le mode même de sa révélation. Au logos universel et abstrait de la métaphysique qui définit notre histoire jusqu’au plus profond de ses crises s’adjoint un logos singulier et défaillant qui nous pousse à nous retourner vers l’abîme que cache finalement mal notre premier commencement. Ce logos produit un séisme profond en tant qu’il est une irruption de la transcendance à partir du champ d’immanence. C’est à ce moment que J. Vioulac exprime clairement sa propre interprétation : « Ainsi peut-on concevoir « l’autre histoire », non pas comme une autre étape ou une autre série d’époques sur la même ligne du temps, mais comme une autre récapitulation d’un même et unique événement (…) à partir d’un autre principe, qui en vérité n’est plus un principe, souverain et tout puissant, mais un Prince, pauvre et humble de cœur. » (P. 240) Le passage du dernier Dieu est donc non pas un terme mais le plus profond commencement : il est l’autre commencement de l’autre histoire. Nous sommes donc face à une situation où il n’y a plus rien à attendre mais juste à commémorer pour sauvegarder ce qui apparaît désormais comme l’essentiel derrière la multiplication des apparences que produit sans nous la machination universelle de la technique.
Il est facile d’anticiper les reproches que peut susciter une telle lecture de l’œuvre de Heidegger qui ne cherche pas à mimer le jeu de l’impartialité théorique. La courte préface de Jean-Luc Marion ne laisse d’ailleurs pas longtemps planer le suspens sur le chemin qui est emprunté. Mais il reste à reconnaître la fécondité d’une proposition même si l’on n’adhère pas forcément à ses conclusions. Celle-ci permet indéniablement de retrouver une cohérence globale dans la philosophie de Heidegger et de mettre au jour le lien qui unit ces deux monstres conceptuels que sont Être et Temps et les Beiträge. On comprend alors que l’ouvrage cherche dans cette récapitulation à atteindre en quelque sorte le point de vue apocalyptique dont il est la description philosophique. Il repense l’œuvre non pas à la fin mais « après la fin » en la circonscrivant ainsi dans une linéarité qui fait sens et qui dépasse les divisions souvent factices entre un Heidegger I et un Heidegger II qui ne serait que l’ombre fantasmée du premier. L’ouvrage permet aussi de donner un sens plus fécond à la critique de la technique et de la politique qu’elle engendre qui avait été au cœur des précédents ouvrages. Il est donc à la fois une fin et un début en tant que l’on peut le penser comme une véritable invitation à relire Heidegger dans sa totalité.
Ugo Batini