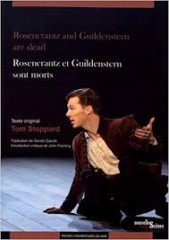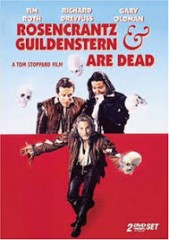Un poème où Victor Hugo raconte sa vie : "Ce siècle avait deux ans..." Vous remarquerez que, comme "Demain dès l'Aube", il ne comporte pas de titre. On lui donne donc pour titre le début du premier vers. Le poème commence par une référence à Bonaparte et à la façon dont le gouvernement de la France est en train de changer, devenant administratif et impérial ("Rome") plutôt que guerrier et uniquement national ("Sparte").
Vous pouvez en écouter la lecture du début sur
https://www.canalacademie.com/ida11409-Ce-siecle-avait-deux-ans-un-poeme-de-Victor-Hugo-de-l-Academie-francaise.html
et sur le site de la BnF il est possible de voir le manuscrit
http://classes.bnf.fr/essentiels/grand/ess_2043.htm
Le poème a été publié dans Les Feuilles d'Automnes, en 1830 : Victor Hugo n'a que 28 ans et déjà il revient sur sa vie et y voit un destin. Il évoque ses écrits, ses succès, mais se dépeint comme une sorte de héros maudit, voué au malheur. En 1831 il a déjà publié des poèmes, des pièces de théâtre dont Hernani l'année précédente, et trois romans. En 1830 sa femme a entamé une liaison amoureuse avec Charles-Augustin de Sainte-Beuve, un ami de Victor Hugo.
Le poème est très long : il faut tout lire avant de choisir, et vous pouvez isoler 15 vers qui se suivent. Attention à bien commencer et couper à un point !
Ce siècle avait deux ans ! Rome remplaçait Sparte,
Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte,
Et du premier consul, déjà, par maint endroit,
Le front de l'empereur brisait le masque étroit.
Alors dans Besançon, vieille ville espagnole,
Jeté comme la graine au gré de l'air qui vole,
Naquit d'un sang breton et lorrain à la fois
Un enfant sans couleur, sans regard et sans voix ;
Si débile qu'il fut, ainsi qu'une chimère,
Abandonné de tous, excepté de sa mère,
Et que son cou ployé comme un frêle roseau
Fit faire en même temps sa bière et son berceau.
Cet enfant que la vie effaçait de son livre,
Et qui n'avait pas même un lendemain à vivre,
C'est moi. -
Je vous dirai peut-être quelque jour
Quel lait pur, que de soins, que de voeux, que d'amour,
Prodigués pour ma vie en naissant condamnée,
M'ont fait deux fois l'enfant de ma mère obstinée,
Ange qui sur trois fils attachés à ses pas
Épandait son amour et ne mesurait pas !
Ô l'amour d'une mère ! amour que nul n'oublie !
Pain merveilleux qu'un dieu partage et multiplie !
Table toujours servie au paternel foyer !
Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier !
Je pourrai dire un jour, lorsque la nuit douteuse
Fera parler les soirs ma vieillesse conteuse,
Comment ce haut destin de gloire et de terreur
Qui remuait le monde aux pas de l'empereur,
Dans son souffle orageux m'emportant sans défense,
A tous les vents de l'air fit flotter mon enfance.
Car, lorsque l'aquilon bat ses flots palpitants,
L'océan convulsif tourmente en même temps
Le navire à trois ponts qui tonne avec l'orage,
Et la feuille échappée aux arbres du rivage !
Maintenant, jeune encore et souvent éprouvé,
J'ai plus d'un souvenir profondément gravé,
Et l'on peut distinguer bien des choses passées
Dans ces plis de mon front que creusent mes pensées.
Certes, plus d'un vieillard sans flamme et sans cheveux,
Tombé de lassitude au bout de tous ses voeux,
Pâlirait s'il voyait, comme un gouffre dans l'onde,
Mon âme où ma pensée habite, comme un monde,
Tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai tenté,
Tout ce qui m'a menti comme un fruit avorté,
Mon plus beau temps passé sans espoir qu'il renaisse,
Les amours, les travaux, les deuils de ma jeunesse,
Et quoiqu'encore à l'âge où l'avenir sourit,
Le livre de mon coeur à toute page écrit !
Si parfois de mon sein s'envolent mes pensées,
Mes chansons par le monde en lambeaux dispersées ;
S'il me plaît de cacher l'amour et la douleur
Dans le coin d'un roman ironique et railleur ;
Si j'ébranle la scène avec ma fantaisie,
Si j'entre-choque aux yeux d'une foule choisie
D'autres hommes comme eux, vivant tous à la fois
De mon souffle et parlant au peuple avec ma voix ;
Si ma tête, fournaise où mon esprit s'allume,
Jette le vers d'airain qui bouillonne et qui fume
Dans le rythme profond, moule mystérieux
D'où sort la strophe ouvrant ses ailes dans les cieux ;
C'est que l'amour, la tombe, et la gloire, et la vie,
L'onde qui fuit, par l'onde incessamment suivie,
Tout souffle, tout rayon, ou propice ou fatal,
Fait reluire et vibrer mon âme de cristal,
Mon âme aux mille voix, que le Dieu que j'adore
Mit au centre de tout comme un écho sonore !
D'ailleurs j'ai purement passé les jours mauvais,
Et je sais d'où je viens, si j'ignore où je vais.
L'orage des partis avec son vent de flamme
Sans en altérer l'onde a remué mon âme.
Rien d'immonde en mon coeur, pas de limon impur
Qui n'attendît qu'un vent pour en troubler l'azur !
Après avoir chanté, j'écoute et je contemple,
A l'empereur tombé dressant dans l'ombre un temple,
Aimant la liberté pour ses fruits, pour ses fleurs,
Le trône pour son droit, le roi pour ses malheurs ;
Fidèle enfin au sang qu'ont versé dans ma veine
Mon père vieux soldat, ma mère vendéenne !