mai20
Un drôle de héros : la guerre vue par Claude Simon dans l'Acacia
dans la catégorie Première

Le Nouveau-Roman s'attaque au statut du personnage de roman auquel il prétend retirer certains de ses attributs : le plus souvent anonymes, privés de déterminations et pris dans des flux de conscience dont les lecteurs sont témoins, les personnages de ce types de romans nous délivrent , ici à la troisième personne du singulier, leurs perceptions du monde qui le entoure et qui les constitue . Reprenant quelques techniques mises au point par les romanciers réalistes , Claude Simon s'efforce de présenter ici son personnage central, un soldat de cavalerie pris dans une embuscade allemande au cours de la Débâcle en mai 1940. Nous verrons tout d'abord comment le romancier restitue le champ de bataille et la confusion qui y règne avant de montrer que la scène s'articule autour des perceptions du héros pris dans une tourmente qui le transforme radicalement .En effet, la première chose qui nous frappe dans ce récit d'attaque surprise, c'est sa confusion que la syntaxe restitue au moyen de longues énumération et de séquences de juxtapositions. Le rythme ainsi créé suggère l'essoufflement du personnage et la rapidité avec laquelle les actions se succèdent. Le chaos prend plusieurs aspects . Voilà un exemple de commentaire littéraire sur cet extrait ...
Intro ....Le contexte historique donné : 17 mai 1940, nous plonge dans une période appelée la Débâcle . Les populations fuient massivement l’arrivée des troupes allemandes qui ont franchi la ligne Maginot et les raids aériens se multiplient sur les convois civils et militaires . D’inspiration fortement autobiographique, ce passage de l’ Acacia nous révèle le désarroi d’un soldat pris dans une embuscade. Plongé dans ses perceptions confuses, le lecteur assiste impuissant à cette attaque surprise d’un commando de mitrailleuses allemandes sur un régiment de cavalerie qui bat en retraite . Tout d’abord, nous verrons comment la vision de la scène s’organise autour des perceptions du personnage avant de montrer quelles images du soldat pris dans la tourmente révèle ce passage.
L’attaque, en effet est décrite du point de vue du personnage anonyme dont les perceptions confuses sont restituées à la troisième personne du singulier : « il ne distingue plus très bien..il ne pourrait pas non plus dire combien l 10 » . Le personnage est à la fois désorienté dans le temps et dans l’espace : dès les premières lignes, on nous précise qu’il a perdu la notion du temps et il ne sait plus après l’explosion où il se trouve .
Ses perceptions sont troublées et évoluent au fil du texte : lorsqu’il reprend conscience à la ligne 14 , il se concentre d’abord sur le danger autour de lui « pour le moment il est uniquement occupé à surveiller avec précaution le paysage » l 15 . On peut alors penser que c’est son instinct de survie qui prend le contrôle de ses facultés et cette impression sera confirmée dans les lignes suivantes, lorsqu’il reprend peu à peu ses esprits avant la nouvelle explosion qui le cloue au sol .
Il est alors décrit comme « sourd, aveugle » à la ligne 42. « le noir, plus aucun bruit (ou peut être un assourdissant tintamarre se neutralisant lui-même » . Le narrateur ici semble même hésiter entre deux hypothèse pour justifier le « black-out » temporaire du soldat.
Afin de restituer le trouble de sa vision, la description prend des allures fantastiques : « émergeant peu à peu comme des bulles à la surface d’une eau trouble apparaissent de vagues taches indécises » Les comparaisons contribuent à traduire cette réapparition progressive d’une vision complète ; Le soldat ne distingue d’abord que des ombres éparses et des figures géométriques qui vont peu à peu se recomposer et s’associer dans son esprit pour former une vision plus nette de ce qui l’entoure : « des triangles des polygones des cailloux de menus brin d’herbe » L’énumération mêle formes et menus objets pour traduire les sensations confuses du soldat , encore incapable encore d’une vision claire et nette .
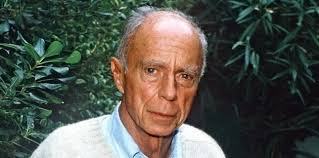
Le réalisme et l’extrême précision des détails produit une sort d’étirement du temps car les opérations décrites s’enchainent dans la réalité en quelques micro-secondes alors que le texte nous les fait vivre , mot par mot, au fil des phrases. Le temps semble ainsi rendu dans une autre dimension, une sorte d’ « instantané décomposé » . Cette page peut se résumer à quelques secondes dans la tête du soldat et c’est pourquoi , on peut avoir la sensation d’un récit en boucle où la dernière phrase « ne voyant plus alors que la barre horizontale dessinée par la haie il court à perdre haleine » ne serait séparée de la première « il peut être environ huit heures du matin » que par l’espace d’un instant .
Les perceptions chaotiques du personnage mimées par des juxtapositions et des cascades de parenthèses , guident notre vision de la scène et l’organisent pourtant en faisant alterner notations précises et floues. Ainsi aux silhouettes évanescentes et difformes des chevaux : « soulevant leurs jambes étirées de sauterelles » ligne 20, nées de la fatigue extrême du soldat et qui révèlent que sa vision est extrêmement perturbée car elle lui fait entrevoir « comme un animal fantastique », succèdent des micro détails hyper précis « flancs de chevaux ,bottes , sabots , croupes » qui témoigne cette fois d’un éclatement des perceptions. Le personnage ne parvient plus à recomposer la réalité qui lui apparait sous la forme de ces « fragments qui se succèdent se démasquent s’entrechoquent, tournoyants » ligne 34 .
Doit -on parler ici de réalisme ou d’hyper réalisme dans l’intention de traduire avec une extrême précision les bouleversements subis par l’explosion qui affecte les perceptions du personnage ? Le style même de Claude Simon formé à partir d’énumérations ininterrompues, tente de restituer ce que les nouveaux Romanciers ont appelé les flux de conscience ; C’est un peu comme si nous assistions en direct à l’activité du cerveau du soldat et que nous suivions , étape par étape , le retour de sa conscience .
Le personnage , en effet, pour les adeptes du nouveau-Roman, perd une partie de ses attributs ; anonyme, sans passé et sans attaches , il est le plus souvent réduit à n’être qu’un flux de perceptions , un flux de conscience . Ici le soldat nous fait vivre la violence de l’attaque et nous permet d’imaginer ce qu’ont vécu les hommes dans cette guerre.
Ce qui frappe tout d’abord , c’est la manière dont il est déshumanisé . Présenté dès le début du passage comme un « somnambule » « les muscles se contractant et se détendant d’eux-mêmes commandés par des réflexes d’automate » , à la ligne 8, il semblerait que sa vie ne tient plus qu’à la fonctionnalité de ses organes et qu’on l’ a privé de sa sensibilité, de sa pensée. De nombreux auteurs ont décrit cette réification de l’homme au coeur de la guerre comme une manière de survivre à l’horreur du champ de bataille.
Claude Simon transforme également son personnage en animal : il évoque d’abord à la ligne 10 « quelque instinct animal qui l’ont fait se relever » en nous précisant toutefois qu’il hésite entre « sa raison » ou « sa volonté » . Simple réflexe animal , instinct de survie qui est dicté par la partie profonde , reptilienne de notre cerveau ou prise de conscience de l’urgence de courir pour survivre, l’auteur nous confronte aux deux possibilités.
Mais il montre un personnage infrahumain, qui sous le choc de l’explosion, se « tient maintenant à quatre pattes comme un chien . » Il semble obéir à un instinct primitif « comme si resurgissait en lui ce qui confère à une bête « chien loup ou lièvre ) intelligence et rapidité en même temps qu’indifférence . » lit -on à la ligne 50. L’utilisation des parenthèses par le narrateur permet d’insérer des détails supplémentaires à l’intérieur même de ce qui fait l’objet d’une description quasi clinique. Les trois animaux cités offrent trois images différentes du soldat : le chien symbolise la servilité et la fidélité à ses engagements ainsi que l’ignominie de la mort dans l’expression « mourir comme un chien »; le loup suggère ici la cruauté du prédateur et la peur qui peut être suscitée par le soldat ; enfin le lièvre évoque le désir de détaler, de s’enfuir avec agilité pour échapper justement aux prédateurs que sont les ennemis sur un champ de bataille.
Transformé en animal, le personnage perd toute forme d’empathie et cela peut paraître un détail choquant pour le lecteur . Il est , en effet, décrit comme indifférent à la mort de son camarade : indifférence jugée d’autant plus monstrueuse qu’elle est « complète tandis que la partie animale de lui fonctionnait à toute vitesse » l 50 . Ce blessé dont la souffrance et les cris l’indiffèrent , est, de plus, présenté comme un proche « à côté de qui il avait vécu mangé et dormi depuis huit mois » est-il précisé à la ligne 55. L’auteur , au moyen de ce détail, fait ressortir la profonde transformation du personnage sous l’effet de cette expérience douloureuse.
Le soldat pris dans la guerre se métamorphose en chaos de perceptions. En quelques secondes , il peut voir s’effacer son humanité ; Présenté comme à bout de forces, le personnage révèle les limites de la condition humaine: Son cerveau paraît d’abord enregistrer des sensations et des impressions avant d’être capable de les reconnecter à la réalité du champ de bataille : « la confusion, le tumulte le désordre, les cris encore , les détonations, les ordres contraires puis lui-même devenu désordre, jurons… » ligne 27. Le personnage n’est plus qu’une sorte d’enregistreur et la syntaxe agitée et tourmentée ne fait qu’imiter, donner forme à ce désordre qui est désormais son identité.
Conclusion ...A travers cette scène de guerre , Clause Simon, confronte son personnage à un déferlement de sensations qui le privent d’une partie de son humanité et de sa conscience ; Ses facultés d’analyse sont altérées et il se réduit à un champ de perceptions confuses ; Adepte des principes du Nouveau-Roman , Simon prolonge l’héritage de Robbe-Grillet et de Sarraute qui tous deux font de leurs personnages de simples enregistreurs caractérisés par leurs regards, leurs voix ou leurs flux de pensées. Le personnage semble ainsi absorbé par les événements qu’il traverse et dont l’écriture tente de restituer le chaos.