nov.15
Gide face à la critique
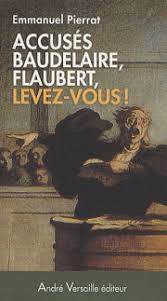
Lors de sa parution, le roman de Gide Les faux -Monnayeurs souleva des réactions diverses et fut d'ailleurs diversement apprécié par la critique littéraire; Que pouvait-on au juste reprocher à Gide ? Plusieurs aspects de la composition littéraire ont été abordés et ont fait l'objet d'avis circonstanciés.
Le plan moral peut tout d'abord être abordé : on se souvient qu'en 1857 Flaubert, romancier réaliste et Baudelaire, poète précurseur du symbolisme, furent tous deux victimes d'un procès retentissant où on leur reprochait, pour l'un de peindre avec complaisance une femme adultère Madame Bovary, qui conduit son mari à la mort et pour l'autre, de composer des sonnets où il est questions d'amours scandaleusement sapphiques. A t-on raison de juger de la qualité littéraire d'une oeuvre au nom de la morale qui y est exprimée par des personnages fictifs ? Baudelaire a du publier une version expurgée de son recueil Les Fleurs du Mal et Flaubert a gagné son procès contre Maitre Pinard : ce parfum de scandale au passage, lui a permis de vendre davantage de roman car les lecteurs étaient curieux de lire les amours interdites de cette femme de médecin de campagne.
On n'a pas oublié non plus que Molière fut censuré et ses pièces interdites parce que des personnages tels que Tartuffe ou Don Juan y tenaient des propos que l'on pourrait qualifier de diffamatoires envers la religion . En résumé, littérature et morale doivent-elles être jugées sur un pied d'égalité ?
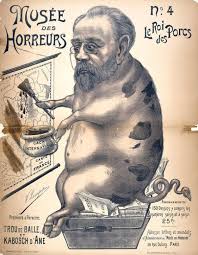
L'auteur de cette critique condamne donc , dans un premier temps, les atteintes à la morale avec une verve ironique : "on regrettera qu'Edouard, à qui la pure seule importe, en mette si peu dans ses moeurs " ; Après avoir habilement présenté l'idéal gidien de roman pur : "un roman qui voudrait "dépouiller le roman de tous les éléments qui n'appartient pas spécifiquement au roman" , le journaliste établit la confusion entre les moeurs d'un personnage fictif et celles de l'auteur dont il réprouve fortement l'homosexualité ; De plus, il conteste le bien- fondé de la tentative de Gide en objectant que la pureté du roman, selon lui, ne "paraît compromise ni par les dialogues, ni par les événements extérieurs, ni même par la description des personnages dont il se dispense, mais il a peut être tort;" Autrement dit, le journaliste déplore ici l'absence de description des personnages qui est justement un des traits majeurs de l'innovation de l'écriture romanesque gidienne. L'auteur associe cette absence de descriptions, de détails sur les personnages à un manque de concret; Le lecteur paraît frustré de ne pouvoir imaginer la "figure" des personnages et selon l'auteur de l'article, la précision des détails n'st nullement réductrice pour l'imaginaire et ne bride pas l'imagination du lecteur ; elle "laisse le champ libre à l'imagination " ; En effet, on peut penser qu'à la différence des images qui fixent les traits des personnages, au cinéma,notamment quand nous allons voir une adaptation d'une oeuvre littéraire, les descriptions romanesques ne sont pas aussi contraignantes pour noter imaginaire; Simplement, Gide les juge inutiles car selon lui, elles alourdissent le propos du roman .
Le journaliste paraît néanmoins séduit par les objectifs de Gide de concevoir et "réaliser le roman à l'état pur " Mais ce sont les moyens employés pour atteindre cet objectif qu'il conteste : il préconise l'emploi d'un certain réalisme qu'il définit par un "souci de vérité directe " : il semble en effet, reconnaissant à Gide d'avoir su exclure les "interventions fantaisistes ", d'avoir introduit "un grand nombre de personnages " et une "complexité de l'action" ou plutôt des actions ; Il souligne toutefois le risque de paraître embrouillé mais ce danger est en partie, évité, selon lui, par le fait que divers épisodes du roman tournent court . Il reproche également au personnage d' Edouard-l'écrivain ,son goût pour la provocation gratuite et le considère à la fois comme un esprit chimérique et dévoyé ; toujours cette condamnation morale qui s'applique à un personnage fictif et qui vient rompre la barrière entre l'art et la réalité .
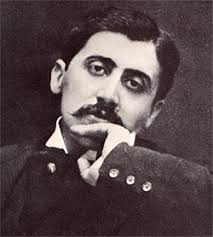
Lorsqu'il critique directement l'homosexualité de certains personnages, il fait allusion à un autre écrivain , Marcel Proust avec lequel il établit une comparaison ; en effet, son personnage elle baron de Charlus s'affiche clairement comme un homosexuel honteux de son inversion (c'était le mot qui était employé à l'époque pour désigner ce qui paraissait à beaucoup comme une forme de corruption des moeurs sexuelles ) ; A noter que Marcel Proust obtint la récompense la plus prestigieuse pour un écrivain, le prix Goncourt pour le premier volet de son oeuvre magistrale: A la recherche du Temps perdu en 7 volumes . La valeur littéraire d'une oeuvre ne doit donc pas se confondre avec sa capacité à respecter la morale dominante . Circonstance aggravante pour le critique: cette homosexualité semble feutrée "point ici de crudité dans les termes" admet-il mais "cela devient insupportable surtout avec ce sérieux et cette fade sentimentalité"; On a presque l'impression qu'il reproche à Gide d'inclure des sentiments dans un amour "dévoyé" et c'est ce mélange qui irrite le critique . On peut également rappeler que les auteurs réalistes du siècle précédent furent également taxés d'immoralité et Zola , en premier lieu, fut taxé d'obscénité et d'outrage aux bonnes moeurs; On jugeait son langage et ses propos orduriers alors qu'il tentait justement de dépeindre la crudité de la misère ; Confondrait -on les moyens et les fins?
Le journaliste reproche également à Gide de faire un portrait sévère des adolescents , d'avoir glissé des injures dans la lettre de Bernard à son père adoptif , d'avoir construit un personnage "immoraliste " avec Edouard et surtout d'avoir critiqué l'institution familiale qui est pour beaucoup l'un des piliers de la société ; En, effet, Gide dépeint la famille comme un "régime cellulaire " ; et le journaliste souligne alors les risques encourus par les jeunes gen qui seraient tentés d'imiter le modèle proposé par Bernard: devenir des voleurs : s'évader certes mais avec "effraction " . Il déplore que Gide, avec son personnage de La Pérouse "vieillard à moitié gâteaux et plus ennuyeux encore " se soit montré un peu léger en tentant d'évoquer le mystère de la rédemption ; Autrement dit, pour ce journaliste, il ne faut ni toucher à la morale bourgeoise , ni à l'institution familiale respectable et encore moins aux dogmes religieux ; Lorsque Gide tente de démontrer, dans son roman, en utilisant notamment le personnage d'Armand, les ravages qu'une éducation rigoriste et puritaine peut provoquer chez un individu, la plupart des critiques n'y voient que des atteintes à la religion là où il est question des bienfaits d'une éducation bienveillante et tolérante;

Le tableau paraît donc fort sévère et pourtant le critique accorde à Gide le statut d' écrivain majeur de son époque en dépit de "quelques erreurs et de quelques négligences " !! Il reconnaît avoir pris plaisir et un intérêt soutenu à lire ce gros roman et conclut sur l'absence de sujet véritable : il reprend alors une définition donnée par Edouard pour répondre à ceux qui l'interrogent sur la nature du sujet de son dernier roman : "la lutte entre les faits proposés par la réalité ,et la réalité idéale " ou entre la matière brute de la réalité et l'effort pour la styliser ; Pour le romancier, la tension créatrice repose sur l'écart entre "ce que la réailté lui offre,et ce qu lui, prétend en faire " ou pour le formuler autrement: le véritable sujet du roman serait "la rivalité du monde réel et de la représentation que nous nous en faisons" Au moins sur ce point, le journaliste a retenu le plus important et ne s'est pas fourvoyé dans des interprétations psychologisantes qui reposent sur la confusion entre auteur et personnage, réalité des intentions et moyens mis en oeuvre par la fiction pour y parvenir.