L'EPARGNE DES FRANCAIS , LE LIVRET A ET SES EFFETS SUR L'ECONOMIE
Par gisele cohen (st germain en laye) le 12 juin 2025, 02:50 - ACTUALITES - Lien permanent

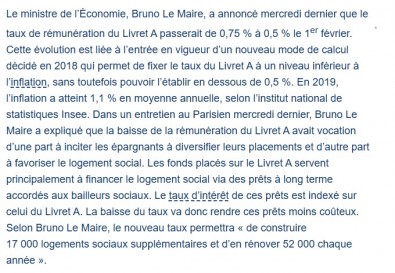 BRIEF ECO JUIN 2025
BRIEF ECO JUIN 2025
L’Insee définit l’épargne des ménages comme la part de leur revenu disponible qui n’est pas utilisée en dépense de consommation finale
. Le revenu disponible comprend les revenus du travail, les revenus du patrimoine et les prestations sociales, déduction faite des impôts.
La dépense de consommation finale correspond aux dépenses réalisées par les ménages pour acquérir des services et des biens, ainsi qu’aux dépenses de santé ou de logement (hors achats de logements, considérés comme des investissements)
. L’épargne peut être conservée sous forme dite liquide, c’est-à-dire immédiatement accessible, chez soi ou sur un compte courant, ou être placée dans différents produits tels que les livrets d’épargne, l’épargne retraite ou l’assurance-vie, ou investie en actions, en obligations (des titres de dette) ou dans des produits financiers tels que les Sicav.
La rémunération des livrets d’épargne est déterminée par un taux d’intérêt nominal. Il est à distinguer du taux d’intérêt réel, qui s’obtient après soustraction du taux d’inflation (1,1 % en 2019). Par exemple, alors que le taux d’intérêt nominal du Livret A était de 0,75 % en 2019, son taux d’intérêt réel a été négatif, à -0,35 %.
John Maynard Keynes estime que l’épargne augmente en fonction du revenu.
L’économiste américain Franco Modigliani formule la théorie du cycle de vie selon laquelle les ménages épargnent – principalement pendant leur vie active – et désépargnent – en particulier pendant la retraite – afin de maintenir constant leur niveau de consommation dans le temps. Cette théorie qui lie l’épargne à l’âge ne se vérifie pas en France où le taux d’épargne des plus de 70 ans est supérieur à celui de l’ensemble des ménages (20,4 % contre 17,1 % en 2011), selon une étude publiée en 2017 par l’Insee.
Quel effet l’épargne a-t-elle sur l’économie ?
Dans un ouvrage publié en 1776, l’économiste écossais Adam Smith juge l’épargne vertueuse pour l’économie puisqu’elle fournit des capitaux aux entreprises, leur permet d’investir et alimente ainsi la croissance. John Maynard Keynes considère que toute hausse de l’épargne nuit au contraire à l’activité et donc à l’emploi. Dans son ouvrage publié en 1936, Cette épargne a ainsi « un effet déprimant sur l’industrie intéressée à la préparation du dîner d’aujourd’hui, sans stimuler aucune des industries qui travaillent en vue d’un acte futur de consommation ».
Source : Brief eco Juin 2025