Bergson, Histoire de l’idée de temps, PUF 2016, lu par Thierry de Toffoli
Par Michel Cardin le 16 juillet 2018, 06:00 - Histoire de la philosophie - Lien permanent
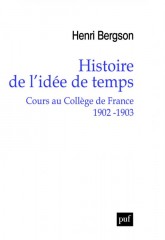
Henri Bergson, Histoire de l’idée de temps - Cours au Collège de France 1902-1903, publié sous la direction scientifique de Frédéric Worms, présenté par Camille Riquier, PUF, 2016 (393 p.). Lu par Thierry de Toffoli.
Bergson, par voie testamentaire, avait formellement interdit toute publication autre que l’œuvre philosophique. Vœu pieux comme nous le savons puisque lettres, notes manuscrites et cours ont déjà été abondamment publiés. Et l’entorse aux dernières volontés de notre philosophe est appelée à se poursuivre puisque l’ouvrage que nous présentons est le premier d’une nouvelle série de cours à paraître aux Presses Universitaires de France.
Nous remarquerons que l’édition de ce cours bénéficie de circonstances particulières. Fidèle auditeur de Bergson, Charles Péguy, fut en effet empêché d’assister à certains cours et, pour s’assurer de la possibilité « d’entendre » tout de même le philosophe, dépêcha deux sténographes qui le transcirent « au mot près ». C’est donc sinon la voix, du moins le phrasé, le rythme et la précision du discours de Bergson qu’il nous est aujourd’hui donné de lire. Mais l’intérêt serait encore limité si le contenu du cours n’était pas bergsonien. Or, sur ce point encore il faut admettre que les leçons au Collège de France ont ceci de singulier qu’elles avaient pour objectif avoué de rapprocher autant qu’il est possible l’enseignement et les travaux personnels, en témoigne la manière dont on peut relier leur propos avec les futures publications (en l’occurrence L’Évolution créatrice) dont certains passages se trouvent précisés ou éclairés. Ces circonstances justifient, nous semble-t-il, qu’on accorde une place à part à ce texte et qu’on s’autorise ainsi à écouter Bergson sans avoir le sentiment de trahir sa volonté.
Ce qui nous semble ici remarquable, dès les premières leçons, c’est cette manière si caractéristique qu’avait Bergson d’aborder les systèmes philosophiques. Délaissant une lecture érudite et muette, il cherchait toujours, fidèle à sa doctrine de l’intuition, à se placer au cœur même d’une pensée afin d’en révéler le sens profond, au risque parfois de nous surprendre par ses conclusions. Se déploie alors sous nos yeux une pensée en acte, vivante, installée dans son propre mouvement, son rythme, alternant les reprises, les images et l’émergence à la fois soudaine et si patiemment préparée d’une idée forte, d’une conclusion décisive.
Les quatre premières leçons sont l’occasion pour Bergson de rassembler quelques-unes des lignes suivies au cours de l’année précédente, tout en posant clairement sa conception du temps. D’emblée, ce qui est posé, c’est l’opposition entre deux manières d’aborder le problème du temps. L’une naturelle et qui va habiter toute l’histoire de la philosophie, l’autre, qui requiert une sorte de distraction de l’intellect, libérant ainsi l’intuition de la durée véritable. Le problème est donc posé à partir de ces deux modes de connaissance, l’une, intérieure, absolue, simple et indivisible, l’autre relative et composée. L’apprentissage d’une langue, le mouvement, l’écriture et la lecture d’un roman, la connaissance de la vie, autant de lignes de faits qui convergent pour montrer que toujours s’oppose le regard du dehors et le regard du dedans. Et à chaque fois ce paradoxe d’une chose qui peut être simple en elle-même et paraître composée sur le plan de la connaissance. Le paradoxe tient à ce que nous ne parlons pas alors de la même chose. Il y a la chose, et il y a la traduction, l’imitation de la chose par la recomposition à l’aide de signes. Une chose simple peut envelopper une totalité complexe et infinie, non pas d’éléments plus ou moins articulés, mais au sens où, par exemple, on peut saisir toute la prononciation anglaise rassemblée en une seule syllabe. En revanche, dès lors qu’on recompose artificiellement la chose à partir d’éléments que l’on va lier de l’extérieur, on se déplace de la chose au signe ou au symbole. La seconde leçon s’ouvre sur l’élucidation de ce problème plus profond qui nous amène au cœur même du fonctionnement de l’intelligence. On voit alors en passant la fécondité de la méthode bergsonienne. C’est en se plaçant à l’intérieur même du processus intellectuel en question que nous comprenons pourquoi il ne peut livrer une connaissance absolue de la chose. Reprenant les exemples précédemment analysés, Bergson en tire les caractères propres au signe : il est général, orienté vers la pratique et joue le rôle de fixateur, d’où la discontinuité qu’on ne peut manquer d’y retrouver, et qui y restera toujours, aussi finement tentera-t-on de recomposer la chose. Cette chose, qui peut être si aisément saisie du dedans comme une totalité, est une réalité métaphysique qui résiste à toute classification, laquelle est cependant nécessaire à la science dont la finalité est d’ordre pratique. D’où la critique bien connue du darwinisme qui ne voit que des éléments s’ajouter à l’organisme au lieu de comprendre qu’un changement minime constitue en vérité une transformation du tout. La leçon suivante va encore approfondir la question du signe à partir de l’analyse du concept, sa formation. On pourrait en effet s’interroger sur le rapport du concept à l’action. Il est en vérité très simple. Si le chaud et le froid admettent d’infinies variations, si on passe de l’un à l’autre relativement par simples nuances, au point qu’on se demande si la distinction a un sens, il suffit d’avoir à sortir et de se demander s’il est préférable de se couvrir (action) pour que tout à coup elle nous semble évidente. Evidente pour une raison pratique, pour agir. Fort de cette conclusion, Bergson peut aborder frontalement la question du temps et de sa nécessaire résistance au concept. L’analyse se poursuit dans la continuité de ce qui précède, l’histoire du concept et cette exigence naturelle de considérer chaque chose à partir des concepts déjà établis. Pensant éclairer une réalité, le temps, par nos concepts, nous ne voyons pas que nous sommes déjà sortis du temps. De fait, vouloir recomposer le temps, qui est un mouvement continu, à partir d’éléments discontinus, est simplement impossible. Aussi loin que nous travaillerons à resserrer un intervalle de temps nous ne ferons encore qu’analyser, décomposer puis additionner des immobilités. L’expérience intérieure, en revanche, nous donne par une « sympathie intellectuelle » l’intuition de la durée et nous permet de la saisir comme un seul mouvement où l’on ne rencontre aucun point, aucune interruption qui permette la représentation. La décomposition ou la recomposition du temps avec des points statiques ne peut qu’échouer à rendre compte de la durée véritable.
A ce point, Bergson va pouvoir aborder plus précisément (leçon 5), ce qui fait l’objet de son cours, l’histoire de l’idée de temps, à travers l’examen de doctrines philosophiques significatives. Il va montrer que toujours, depuis la Grèce antique jusqu’à Kant, c’est le point de vue du concept, le point de vue extérieur, qui a dominé la pensée du temps, rendant impossible, sinon par soudaines et brèves intuitions, l’appréhension de la réalité du temps, laquelle constitue en vérité la véritable clé de toute métaphysique. Le logos, si cher aux Grecs, est en effet devenu le nom d’une pensée démonstrative, d’une pensée qui se dit et où, en témoigne l’Ecole d’Elée, ce qui ne s’exprime pas n’est pas. Par cette voie, on ne reconnaît d’être qu’à ce qui est un, on rejette le multiple. Une chose est ou n’est pas quelque chose, il n’y a pas de mesure possible, de solution de continuité entre une chose et son contraire. On comprend donc que tout ce qui est temporel et changeant ne pourra qu’être recomposé extérieurement à partir d’éléments eux-mêmes extérieurs les uns aux autres, loin de ce que l’on trouve quand on se place dans le mouvement du réel. L’histoire commencera donc avec Platon qui nous offre, dans le Timée, la première théorie du temps, « image mobile de l’éternité selon le nombre ». Bergson distingue chez Platon deux modes de penser. Le premier qu’on connaît sous la dénomination de théorie des Idées, tâche de résoudre le problème tel qu’il a été laissé par les Éléates. Tandis que le réel est, selon Bergson, le devenir lui-même, les termes du langage (enfant, homme, etc.) ne désignent que des vues. Partir du concept, ou des Idées (chose qui se comprend puisque c’est naturellement que nous les formons) implique que de là on rende compte du devenir, de ce monde sensible. Délaissant alors le terrain du raisonnement, Platon, loin de dédaigner ce problème comme on l’a trop souvent affirmé après Aristote, utilisera le mythe, l’histoire, pour rendre compte du changement, impensable sur le plan des Idées. Ici apparaissent le démiurge, un réceptacle indéterminé (la matière d’Aristote) et l’âme du monde. Surtout, le devenir va se définir comme une déchéance de l’éternité, conception appelée à marquer toute l’histoire de la philosophie. Cette déchéance, chez Platon, reste cependant contingente (c’est l’intervention du démiurge, c’est le récit mythique que la théorie des Idées n’implique pas en soi). Comment comprendre que tout ne se réduise pas à l’intelligible pur et à l’éternité ? Pourquoi le démiurge, pourquoi cette âme du monde et enfin pourquoi la temporalité qui l’habite ? Pour rendre la chose plus intelligible et comprendre qu’avec l’éternité soit donné le temps, il faudrait que soit posé quelque chose qui s’en rapproche autant que possible, à la limite ; une sphère tournant sur elle-même, qui aurait à la fois l’immutabilité du lieu (en considérant le tout, il est immobile) et le mouvement au niveau des parties. Un tel mouvement, selon le nombre, ce serait le temps, lequel pourrait se communiquer de proche en proche à des niveaux plus bas, tout en restant le plus près possible des Idées et donc de la perfection. C’est ainsi que Bergson pense une solution de continuité entre Platon et Aristote. L’une des conclusions remarquables de son cours est sans doute l’idée que les deux philosophes sont bien moins opposés qu’on ne le dit ou que ne voulait l’admettre Aristote. Ce dernier a le mérite de traiter la question du temps de façon plus explicite et non sous la forme d’une histoire ou d’un mythe. Mais tous deux héritent du même problème, expliquer le changement tandis qu’on admet qu’une qualité est ou n’est pas et qu’on ne saurait être en même temps une chose et une autre comme semble l’imposer le devenir. Il faut donc un troisième terme. Tous deux visent également cette science éternelle, une vérité déjà-là, qu’il faut simplement découvrir. S’en tenir, pour les opposer, à la querelle entre transcendance et immanence ne conduira nulle part, tant ces termes spatiaux sont flous. Au cœur de la doctrine d’Aristote, il y a cependant une différence importante et qui permettra de donner à cette théorie du temps, dont les philosophes resteront les héritiers (en théorie), une cohérence et une clarté qui manquaient chez Platon. Cette différence ne tient pas, selon Bergson, à un rejet de la théorie des Idées mais plutôt à un changement dans la manière de les considérer. Chez Platon les Idées, toutes les Idées, sont, sur le plan intelligible, parfaitement achevées, elles sont la réalité. Il suffit donc d’écarter le voile pour y accéder. Chez Aristote, il y a certes la Pensée de la Pensée qui montre un parfait achèvement, mais les Formes, qui remplacent les Idées, ne le sont pas. Il faut encore que quelque chose se produise pour passer de la puissance à l’acte. Cet écart est précisément le devenir, lequel se retrouve concrètement quand il s’agit d’expliquer le monde. Par exemple, la Forme de l’humanité est en devenir, l’humanité se cherche matériellement sans jamais parvenir à se réaliser totalement et en ce sens elle imite l’éternité sans l’atteindre. Voilà d’ailleurs en quel sens on doit comprendre cette immanence dont on parle à propos d’Aristote. L’élément fondamental de l’analyse est alors que même si on part toujours de l’acte, Dieu, la Pensée de la Pensée (sans quoi rien ne serait), de la même manière qu’en se donnant la lumière on se donne un rayonnement qui faiblit et donc l’obscurité comme diminution de la lumière, on se donnera nécessairement ici, en terme de causalité donc, la diminution de la Forme de Formes, la matière. Et par là on se donne aussi le devenir, le monde sensible, qui aspire à devenir Forme en acte sans jamais achever son mouvement.
Penser le temps, ce sera ici se placer dans la perspective du mouvement dont il est une modalité. Parce qu’il n’y a pas de commencement absolu, le changement doit être vu comme perpétuel et suppose, pour être expliqué, un premier moteur, Dieu. Non pas le Dieu de Saint Thomas, qui est celui d’un commencement, en dépit des rapprochements faits sur le mode de raisonnement des deux philosophes. Il n’y a pas de cause au sens historique chez Aristote mais une coéternité. Ainsi, à l’image du Dieu immobile, on peut penser un monde dont le mouvement circulaire imite l’éternité. Le monde sensible est cet entre-deux, avec d’un côté la Forme, de l’autre la matière. Mais ce que retient précisément Bergson, c’est qu’encore une fois, le processus se comprend si on part de Dieu pour expliquer les Formes, puis le monde sensible, mais qu’on ne le comprendrait pas si on partait du monde sensible pour remonter. Tout est là. Il s’agit, encore une fois, de penser toute chose à partir du concept intellectuel et d’en tirer le monde, mais un monde qui ne sera pas compris du dedans. On le voit parfaitement en reprenant la question du temps. Dans une telle perspective, tant qu’on est dans le mouvement, pas de temps. Pour saisir le temps, il faut une scission, distinguer deux maintenant, les nombrer, les relier. De fait, on recompose en passant à côté de la temporalité réelle. Toujours le temps se réfère au ciel, à l’immobilité. Bergson souligne de nouveau la proximité de Platon et Aristote, dont l’opposition n’est que celle qu’on peut trouver entre l’implicite et l’explicite. Là où Platon évoquait un démiurge à travers un mythe, Aristote élève Dieu au niveau de l’Idée et résout le problème avec le concept de causalité. Non que le Dieu produise le monde, mais il l’implique par l’attraction qu’il exerce. N’oublions pas, nous dit Bergson, et ceci va longtemps habiter la philosophie, qu’avec la cause, c’est-à-dire le plus, on se donne l’effet, le moins. D’où d’ailleurs l’impossibilité de penser le processus de création tel que Bergson l’exigerait. Quoi qu’il en soit, le cours va alors s’orienter vers la philosophie de Plotin où sera parfaitement exprimé ce principe de l’irradiation qui permet de comprendre le processus qui, une fois posé le premier principe, comme dans l’image de la lumière, conduit à poser en même temps l’obscurité et tout ce qui suit.
Bergson va consacrer plusieurs leçons à Plotin, lui conférant une place privilégiée qui montre l’importance qu’il donnait au philosophe. Après avoir rappelé la doctrine des trois hypostases, il recentre son propos sur ce qui lui paraît essentiel : il s’agit éminemment d’une doctrine dont l’idée centrale est psychologique, préparant ainsi la modernité. Et plus particulièrement par la place accordée à la théorie de la conscience, véritable nouveauté pour la pensée grecque. Il reste néanmoins un penseur fidèle à la tradition grecque et donc il ne faudrait pas croire qu’il parvienne à penser l’Idée comme modalité de la conscience. C’est la conscience qui est une modalité de l’Idée. Celle-ci, par un dédoublement, tombe d’elle-même, d’où la conscience. Ce point est capital pour comprendre la théorie du temps en ce sens que le déroulement de l’Idée d’un individu, Socrate par exemple, comme conscience, c’est le temps lui-même. Et à vrai dire, c’est bien d’abord le temps intérieur, à ceci près qu’il n’est pas considéré comme un plus, une lumière, mais comme un moins, une dégradation, un obscurcissement. Il y a en vérité chez Plotin une intuition qui ne sera malheureusement pas suivie, qui fait de la conscience une synthèse d’états qui ne sont pas nécessairement conscients. Certes, ce n’est pas encore la conception de la conscience que Bergson appelle de ses vœux, mais c’est une intuition remarquablement moderne, trop atomistique il est vrai, sur la manière de comprendre cette synthèse ; provisoire aussi, car Plotin ne s’attachera pas jusqu’au bout à cette lecture, mais c’est indéniablement un pas décisif. On trouve en effet chez lui une autre conception de la conscience qui en fait une analyse de l’Idée, l’Idée de l’individu par exemple. Revient alors ce jugement qui y voit un affaiblissement. L’acte ou la pensée sans conscience sont explicitement considérés comme plus entiers, on y coïncide véritablement avec soi-même. Il n’est donc aucunement question ici de donner un privilège quelconque à la conscience. Quoi qu’il en soit, c’est par le mouvement de l’âme que se comprendra la temporalité. Si les âmes, dans l’intelligible, se pénètrent réciproquement les unes les autres, constituant une totalité indivisible, elles vont penser, illusoirement, gagner plus d’indépendance, se posséder davantage soi-même en descendant vers la matière qui se caractérise, elle, par l’extériorité réciproque. En s’éloignant, en glissant dans l’obscurité et en s’enveloppant dans la matière, l’âme descend dans ce corps dont on doit dire qu’il est en elle plus qu’elle n’est en lui. Cette descente est par ailleurs pensée comme nécessaire par Plotin ; il y a une force inhérente à ce qui est un à dérouler ainsi ce qu’il contient dans la multiplicité. Le temps sera donc cette vie de l’âme, ce transport d’une manifestation à une autre. Mais ce faisant, on aperçoit ici ce qui est à l’origine des problèmes rencontrés par toute l’histoire de la philosophie concernant le temps et la liberté. Ce nécessaire déroulement, l’idée de causalité rigide qui en découle, vont rendre vaines les intuitions pourtant claires de la réalité de la liberté. Quand on a posé que la cause contenait toujours plus que l’effet, que tout était déjà dans l’unité primitive, que le temps ne saurait que dérouler un contenu en l’appauvrissant plutôt que permettre une création, on a scellé la question de la liberté, on a perdu toute chance de retrouver l’intuition de la vie et de la liberté réelles, celles que l’on peut saisir du dedans, en partant de l’expérience intérieure et non de l’unité. On voit ici combien la pensée de Plotin devient fondamentale, elle porte en elle un double visage. D’un côté on y retrouve la pensée grecque et ses écueils, d’un autre côté il y a cette absolue nouveauté d’une approche psychologique qui l’en éloigne considérablement. A tel point que Bergson montre qu’il y a déjà en germe la théorie de l’harmonie préétablie qui se dépliera totalement chez Leibniz.
Cette modernité de Plotin permet une transition aisée vers la pensée de la Renaissance et des modernes. Bergson se montre ici attentif au contraste entre les réminiscences de philosophie ancienne et les intuitions novatrices de la science moderne qu’on tente malgré tout de faire entrer dans ce cadre antique. Tout en rappelant ses propres positions sur la durée, la réalité aussi de la durée des choses extérieures (l’exemple bien connu de l’eau sucrée), il souligne l’infléchissement capital qu’impulsent les néoplatoniciens en inversant la hiérarchie et en faisant passer l’âme du monde, troisième hypostase chez Plotin, au premier plan. C’est à présent, comme on peut le voir chez Nicolas de Cues, l’univers lui-même qui est psychique. De cette période, Bergson retient surtout les progrès accomplis en mathématiques où l’on s’intéresse non plus simplement aux positions et aux figures, mais à la génération même des figures. Le mouvement acquiert une intériorité qui le libère de l’immobilité grecque. Revenant à la philosophie et rencontrant Descartes, Bergson voit d’emblée une tension entre deux tendances. L’exercice du doute conduisait véritablement Descartes à l’acte, au « se faisant » de l’acte du je pense en lequel réside la vérité qui s’engendre dans le refus même des jugements déjà-là, des systèmes établis. Mais rapidement Descartes éprouvera le besoin de fixer dans le concept, dans le système, les fruits de son intuition. N’ayant pas fait table rase de l’héritage antique, habité par les mathématiques, il ne pousse pas l’expérience au point de saisir la continuité de la durée, il s’effraie au contraire de la discontinuité supposée des intuitions et veut s’assurer la permanence. Et c’est pourtant à l’expérience intérieure qu’il revient quand il parle de la liberté, conception étonnante quand on pense qu’en même temps il fait de Dieu celui qui recrée chaque chose à chaque instant. De fait, les problèmes hérités de la pensée grecque ressurgissent tandis que l’intellectualisme triomphe. C’est d’ailleurs l’esprit de système qui va encore dominer après lui, chez ses héritiers, Spinoza ou Leibniz notamment. Tandis que Descartes avait le mérite de partir de l’intuition et de la durée, avec Leibniz et Spinoza, c’est avec Dieu le point de vue de l’éternité qui est posé dès le départ. En témoigne la doctrine des monades qui sont pensées comme des totalités, des vues sur le tout et qui ne communiquent pas entre elles, qui n’ont pas de dehors, bref, le prédicat est toujours contenu dans le sujet et il n’y a à proprement parler pas de durée réelle, pas de création, pas de devenir véritable. Le monde sensible, celui qui nous apparaît précisément comme un devenir, où devrait se faire l’expérience du temps, n’est rien d’autre que le monde intelligible confusément perçu, du point de vue humain donc. Il n’est que le lieu du déploiement de l’harmonie préétablie, calculée par Dieu lui-même, et dont l’existence n’implique que l’espace, comme ordre de coexistence, mais en aucun cas un temps réel, intérieur.
La dernière leçon, tout en s’attachant rapidement à l’apport kantien, dresse surtout un bilan de cette histoire de l’idée de temps. Il y avait deux directions possibles. L’intuition d’un côté, la science selon les concepts de l’autre. Les outils ont changé, mais c’est bien l’idéal d’une science éternelle qui tient le dernier mot, comme en témoigne encore l’effort kantien, même si le présupposé a été réduit le plus qu’il était possible. Le Dieu de Descartes ouvrait trop de possibles avec sa liberté infinie, le Dieu de Leibniz se réduit à l’intelligibilité du tout, chez Kant, l’unité objective de la conscience suffira. Mais en déplaçant dans l’esprit lui-même l’exigence de cohérence et d’unité, il n’en poursuit pas moins l’idéal d’une science définitive, d’un système de la nature, etc.
Doit-on dès lors penser que l’effort de la pensée se condamne ainsi à toujours laisser échapper ce réel pourtant simple à saisir et qu’il s’agirait ensuite d’approfondir dans toute sa richesse, sous toutes ses couches ? Certes non. La science déjà montre qu’elle ne croit plus à cette systématicité simple des systèmes. L’objectif de Bergson était de montrer comment, au cours de l’histoire, les systèmes philosophiques avaient su connaître des transformations, même si celles-ci avaient été étouffées et enfouies par le retour à l’esprit d’unité, la tyrannie du concept. Mais l’histoire continue et l’on peut envisager un effort plus important pour enfin suivre les intuitions. On le peut, dira-t-on, mais l’a-t-on fait ? Au fond, la question qui nous vient à l’esprit après avoir lu ce cours, est celle de savoir si cet esprit antique, cette exigence symbolique et conceptuelle, est ou non toujours à l’œuvre dans les productions de l’esprit. Nous laisserons à chacun le loisir de répondre à cette question, nous pensons pour notre part que les matériaux ont encore changé, le langage a encore évolué, la science ne cesse d’ouvrir de nouvelles perspectives, il ne s’est pas produit pour autant de révolution dans la manière dont l’homme se pense. La mobilité qui domine notre représentation du monde reste une mobilité conceptualisée, opératoire, reconstituée. De fait, nous sommes toujours bien loin de cet approfondissement qu’appelait Bergson de tous ses vœux. Raison supplémentaire, s’il en fallait, de lire et relire ce beau texte, d’écouter cette parole. Nous avions ouvert notre propos sur la question de la légitimité de publier ce que Bergson voulait tenir à distance des maisons d’édition. Mais c’est parce qu’il réussit son pari de nous pousser, en l’écoutant, à revenir au cœur même de la pensée vivante, faisant fi des critiques que ne manqueront pas de lui adresser les historiens de la philosophie soucieux de respecter la lettre des textes plutôt que l’esprit, de voir les détails qui rigidifient la pensée plutôt que les enjeux qui la fécondent, que Bergson nous parle encore, autrement, de ce qu’il ne cesse de nous dire dans ses textes publiés. C’est la parole même de Bergson qui, sans doute, justifie la publication d’un tel ouvrage. Nous ne pouvions suivre dans tous les détails les mouvements de cette pensée authentique et nous n’aurons su qu’en donner une pâle image, mais nous ne pouvons qu’encourager tous ceux, pour qui les questions philosophiques comptent plus que la simple érudition exégétique, à lire attentivement ces leçons.
Thierry de Toffoli (10/10/2017).